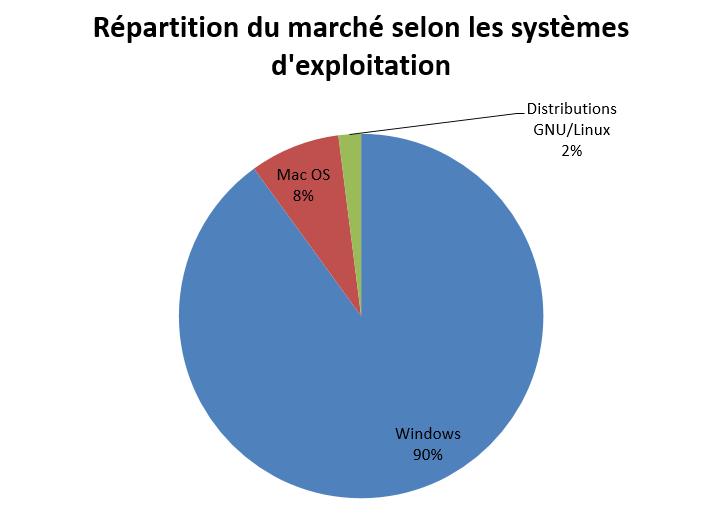Sébastien Minister - Sheila: he publishes a book, she talks about it
Un soir, en voyant apparaître Sheila à la télévision dans une robe Azzaro, Sébastien Ministru, 13 ans, saute de joie et casse l’assise en bois du canapé du salon familial. Pour notre collègue, qui se sait déjà “différent des autres”, la chanteuse fait figure de refuge, et sans doute de miroir. L’anecdote suffit à saisir notre émotion lorsqu’on découvre Sheila et Sébastien si proches dans cet hôtel qui abrite leur rencontre, presque comme frère et sœur pour parler de La garde-robe, le nouveau roman du journaliste bien connu des lecteurs de Moustique. Le parcours de Vera, héroïne du livre, ressemble peut-être à celui de Séba (pour les intimes). Les deux sont des transfuges de classe issus de l’immigration italienne et élevés dans une cité minière, même si le récit déploie un destin féminin qui évoque celui de Sheila, née Annie Chancel en 1946, symbole d’un showbiz tyrannique dont elle a dû s’émanciper, et dont Vera épouse certaines métamorphoses.
Quand avez-vous découvert Sheila? Et quel lien faites-vous entre la chanteuse et l’origine de votre livre?SÉBASTIEN MINISTRU - J’ai reçu mon premier 45 tours de Sheila à 6 ans. La chanson s’appelait La famille… À partir de là, je casse les pieds à mes parents pour m’acheter ses disques suivants. Enfant, je suis déjà conscient de ce que me réserve l’extérieur, je sens l’aversion des autres. Je sens que je vais devoir organiser des stratégies de fuite pour éviter les remarques brutales et blessantes. Dans cette peur-là, Sheila devient une figure protectrice. Et je me fichais à l’époque ce qu’on pouvait dire d’elle… Elle remplissait ma solitude. Mais je n’ai pas pensé à elle en pensant à l’histoire de Vera, l’héroïne de mon roman. Je ne savais qu’une chose: une femme meurt et on découvre qui elle était à travers sa garde-robe. C’est tout. Après, le livre s’est écrit presque sans moi, dans une sorte de concordance entre le processus d’écriture, la mécanique de la mémoire et celle de l’inconscient.
Sheila, qu’est-ce qui vous a le plus touchée dans l’histoire de Vera, l’héroïne fictive de La garde-robe dont une partie se déroule dans le milieu du show-business des années 60 et 70?SHEILA - L’histoire de Vera n’est pas la mienne, mais il y a des parallèles. J’ai pris le livre comme le reflet d’une société et d’une époque – la mienne. Le roman raconte ce qui se passait à l’époque pour les artistes dans ce milieu du showbiz. C’est très bien vu. Très réel parce que, dans le livre de Sébastien, il y a aussi l’œil du journaliste. J’ai traversé cette époque jusqu’aux années sida qui sont aussi évoquées dans le roman à travers le mari de Vera qui était homosexuel. Mais ce n’est pas mon histoire, c’est l’histoire du showbiz. D’ailleurs Vera est morte et je suis bien vivante (rire).
Vera vient d’un milieu ouvrier. Comme elle, vous avez commencé à travailler très jeune en faisant les marchés. Quelle adolescente étiez-vous?SHEILA – Contrairement à Vera, mes traumatismes ne sont pas venus de mon enfance mais du showbiz. J’ai été très aimée par mes parents. Je viens d’un milieu de commerçants et j’ai appris à travailler très tôt. Mais Vera et moi, nous sommes des affranchies qui voulions notre indépendance. J’ai fait les marchés en sachant que ça me donnerait plus de liberté que l’école ne m’en donnait. Je n’avais pas de volonté d’émancipation sociale, mais je voulais être artiste, saltimbanque. Je suis allée à droite, à gauche pour essayer de trouver des groupes de musique… Dans le livre, je trouve joli que Vera démarre son itinéraire par la couture. Parce que, c’est vrai, dans les années 60, les filles apprenaient la couture à l’école et Vera a envie de créer et d’être différente. Elle va commencer en osant se créer ses propres habits.

Sébastien, le livre est construit sur l’idée de la garde-robe. Quelles sont les tenues de scène de Sheila qui vous ont marqué?S.M. – Il y en a beaucoup! Chacune de ses silhouettes était liée à la scénographie d’une chanson. Quand elle chantait Le kilt, elle portait un kilt. Quand elle chantait Le folklore américain, elle dansait dans une jupe à franges. J’ai une tendresse particulière pour la minirobe orange vue dans la chorégraphie de L’heure de la sortie dans le film Bang Bang. Mais je me souviens d’une flamboyante combinaison à paillettes bleue qu’elle portait quand elle chantait Tu es le soleil, et d’une spectaculaire cape rouge doublée de blanc pour Un prince en exil. Tous ces vêtements qu’on voyait à la télé étaient éblouissants. Je peux dire que, sur la question du style, très jeune, Sheila a fait l’éducation de mon œil.
Aviez-vous conscience de la manière dont vous touchiez la jeunesse?SHEILA – Certainement pas. On vivait l’instant. Jamais je n’aurais imaginé que des robes ou des chansons influencent la jeunesse. En 1962, j’ai 16 ans, on est loin de la libération de la femme. La majorité est à 21 ans, les jeunes filles ne portent pas de jeans, ne se maquillent pas, ne sortent pas sans l’autorisation des parents. Les adolescents n’ont pas droit à la parole. La génération yéyé a été la première à parler, à dépasser les interdits. On nous disait qu’on faisait trop de bruit mais soixante ans plus tard, on se rend compte qu’on a ouvert une brèche et qu’à travers la chanson, on peut voir l’évolution de la femme.
Dans le livre de Sébastien, on voit un univers de la musique cadenassé par les hommes. À l’époque, étiez-vous traitée différemment des chanteurs?SHEILA – Les hommes n’avaient rien à prouver parce qu’ils étaient des hommes. Ça reste vrai aujourd’hui. Je me souviens d’une émission des Carpentier avec Johnny, Sardou, Eddy Mitchell, Sylvie et moi. Quand on a eu fini de chanter, Sylvie et moi, les mecs nous ont dit “Les mamans, elles peuvent rentrer à la maison maintenant” – ce qu’on n’a pas fait bien sûr! Voilà l’esprit macho de l’époque…
Malgré le succès phénoménal de vos tubes, les millions de disques vendus, comment vous êtes-vous rendu compte que vous faisiez partie d’un système brutal – comme Vera affrontant son imprésario qui “dresse ses jeunes poulains comme des animaux de cirque”?SHEILA - En 1962, on ne connaissait rien. J’étais mineure, mes parents avaient signé un contrat sans savoir ce qu’ils signaient. Je ne pensais pas à l’argent, aux droits d’auteur, je ne savais même pas que ça existait. Mon imprésario, Claude Carrère, a d’abord été celui qui réalisait mes rêves. Il était comme mon grand frère, mais aussi l’homme qui m’a fait le plus de mal. Il m’a jetée en pâture. J’ai découvert seulement il y a dix ans que la rumeur sur mon identité venait de lui (à l’époque, un article prétend que Sheila est un homme – NDLR). Il ne s’est jamais excusé. Ça reste traumatisant pour moi.
Après le succès de Spacer en 1979, vous rompez avec votre manager. Peut-on dire que vous vous êtes émancipée par le disco?SHEILA - L’émancipation est arrivée un peu avant. J’ai commencé à demander des comptes, et puis avec la période internationale du disco, j’ai compris qu’il y avait un bât qui blessait. Le fait de voyager, de partir aux États-Unis et de travailler avec Nile Rodgers a fait qu’au retour en France, je ne pouvais plus travailler avec ces gens-là.
Dans une confession finale de Vera, vous écrivez: “Je n’étais pas si éloignée de celles qui travaillent à l’usine, j’étais une bonne ouvrière du show-business”…S.M. – Dans cette confession, que Vera fait pour les besoins d’un documentaire, elle se permet un parallèle entre le boulot de chanteuse de variétés, qui produit des tubes à la chaîne, et celui d’ouvrière – comparaison qui lui sera reprochée d’ailleurs par un personnage du livre. Mais dans ce milieu, dans les années 60-70, les filles, encore plus que les garçons, ont été des objets soumis. Sans compter le côté manufacturé des chansons de Sheila qui en a fait une cible pour l’intelligentsia où elle était discréditée. Je ne sais d’ailleurs pas comment elle a pu résister à autant de critiques.
Sheila, qu’avez-vous osé dans votre vie?SHEILA – J’ai osé être une femme dans un monde d’hommes. Et je suis encore là. Et comme Vera dans le livre de Sébastien, j’ai toujours été là où on ne m’attend pas. Ce livre ne raconte pas ma vie, mais il reflète le monde dans lequel j’ai vécu.
Le roman de Vera
La garde-robe, l’histoire d’une femme blessée qui a traversé les époques sans avoir jamais baissé les bras.
Il y a du Pedro Almodóvar chez Sébastien Ministru qui sera encore dans l’actualité en novembre avec la reprise de son spectacle à succès Cendrillon, ce macho! Un Pedro Almodóvar qui aurait vécu le showbiz français des années 60-70 à travers la double émancipation de Vera Dor, chanteuse de variétés d’origine italienne, née au pied des terrils, se libérant d’un imprésario abusif et découvrant la manière d’être soi.
Si le premier roman de Sébastien Ministru, Apprendre à lire (prix de la Fondation Prince Pierre de Monaco, prix Sander Pierron de l’Académie de Belgique) s’inspirait du destin paternel, celui-ci est du côté du féminin et explore avec élégance son goût pour la mode, la chanson populaire et la fiction qui transfigure les destins sociaux.
Suivant un dispositif narratif délicieusement fétichiste (chaque chapitre s’effeuille comme une tenue – de la robe trapèze à la cape en zibeline, en passant par le smoking), on suit la carrière heurtée de Vera à travers son vestiaire que ses nièces doivent vider à sa mort. De sa fascination pour les chanteuses populaires malmenées par la loi du showbiz (on croit retrouver des bribes de Sheila, de Françoise Hardy ou de France Gall), Sébastien Ministru fait une matière d’écriture acidulée et cruelle qu’on retrouve chez François Ozon ou Jacques Demy. Il y trouve aussi le creuset secret qui comble par l’écriture une perte impossible à combler – celle de la mère – et donne à lire un bel ouvrage.
La garde-robe, Grasset, 182 p.