Le coût humain des armes incendiaires et les limites du droit international Résumé | HRW Human Rights Watch Human Rights Watch
Depuis dix ans, l’utilisation d’armes incendiaires, notamment les munitions au phosphore blanc, en Afghanistan, à Gaza, en Syrie et ailleurs, est un sujet de forte préoccupation pour des dizaines d’États parties à la Convention sur certaines armes classiques (CCAC). Nombreux, parmi ceux-ci, appellent au renforcement du Protocole III de la Convention, le seul instrument international spécifiquement prévu pour réglementer les armes incendiaires. Cependant, certains pays, minoritaires, bloquent ce processus et, les réunions annuelles de la CCAC reposant sur le consensus, les discussions s’enlisent dans un débat sur la question de savoir s’il convient d’inclure ou non ce point à l’ordre du jour. Or la question n’est pas de trancher s’il y a lieu d’aborder ce sujet, et les États devraient plutôt agir afin de gérer les conséquences humanitaires de ces armes.
Le présent rapport entend recentrer le débat sur les armes incendiaires en mettant en lumière l’effroyable coût humain qu’engendre leur usage. L’approche humanitaire consiste à formuler cette question, de façon plus appropriée, à l’aune de la souffrance humaine et à souligner la nécessité urgente de réviser et de renforcer le droit international en vigueur régissant ces armes.
Les armes incendiaires produisent de la chaleur et du feu par la réaction chimique d’une substance inflammable. Elles infligent des brûlures atroces, qui pénètrent parfois jusqu’aux os, et peuvent causer des lésions respiratoires, des infections, des traumatismes et des défaillances organiques. Avec le temps, les contractures — c’est-à-dire le resserrement permanent des muscles et d’autres tissus — entravent la mobilité, alors que le choc de l’attaque initiale, les traitements douloureux et les cicatrices, d’aspect changeant, engendrent des dommages psychologiques et l’exclusion sociale. Les incendies causés par les armes incendiaires peuvent également détruire les structures et les biens des civils, détériorer leurs cultures et tuer leurs élevages. Par ailleurs, dans le contexte des conflits armés, l’insuffisance des ressources à la disposition des services médicaux alourdit le processus, déjà difficile en soi, de traitement des brûlures graves.
Le Protocole III de la CCAC, adopté en 1980, vise à prévenir ces effets nocifs en réglementant le recours aux armes incendiaires, mais son efficacité, en tant qu’instrument humanitaire, est limitée en raison de deux lacunes majeures. Premièrement, on peut considérer que du fait de sa définition étroite, elle exclut certaines munitions polyvalentes causant indirectement des incendies, notamment celles contenant du phosphore blanc. Deuxièmement, les restrictions d’utilisation prévues dans le protocole sont moins contraignantes pour les armes incendiaires lancées depuis le sol, par rapport à celles larguées par aéronef, même si les dommages causés sont semblables.
La prochaine Conférence chargée de l’examen de la CCAC, prévue fin 2021, offre aux États parties une occasion cruciale d’évaluer la pertinence du Protocole III, l’objectif étant d’entamer un processus visant à combler ses lacunes. Mais avant toute chose, les États devraient se mettre d’accord, lors de leur prochaine réunion, pour inscrire le Protocole III à l’ordre du jour de cette Conférence[1].
Pour souligner l’impératif humanitaire qui sous-tend cet appel raisonnable, le présent rapport décrit de façon détaillée les effets immédiats et à long terme des armes incendiaires et illustre la souffrance humaine qu’elles engendrent au travers d’études de cas réalisées à Gaza, en Afghanistan et en Syrie. Il s’appuie sur plus d’une dizaine de longs entretiens avec des survivant·e·s, témoins, médecins, infirmier·ère·s, journalistes et expert·e·s, ainsi que sur une étude approfondie de la littérature médicale. Le rapport explicite ensuite les lacunes du Protocole III et analyse le débat qui a eu lieu lors de la réunion de la CCAC de 2019, où s’est exprimé un important soutien en faveur de la révision et du renforcement de l’instrument existant.
Human Rights Watch et l’International Human Rights Clinic de la faculté de droit de Harvard (IHCR) exhortent les États parties à la CCAC à intensifier dès à présent leur travail sur les armes incendiaires de façon à être prêts à prendre des mesures concrètes lors de la Conférence chargée de l’examen de la CCAC de 2021. En particulier, les États parties devraient :
Les armes incendiaires, quel que soit le système de lancement, engendrent une considérable souffrance humaine dans la suite immédiate d’une attaque, mais aussi au cours des semaines et mois suivants. Elles infligent d’atroces brûlures qui nécessitent des traitements douloureux. Elles peuvent également endommager le système respiratoire et causer une détresse émotionnelle. Les munitions au phosphore blanc, qui provoquent des blessures tout aussi sévères que celles provoquées par les autres armes incendiaires, ne sont pas prises en compte dans la définition du Protocole III de la CCAC. Le phosphore blanc peut brûler jusqu’aux os, et sa combustion se poursuit à l’intérieur du corps et se ravive au moment du retrait des bandages.
Brûlures
Les brûlures caractéristiques infligées par les armes incendiaires sont souvent graves, voire fatales. La gravité des brûlures dépend principalement de la surface corporelle totale touchée, plutôt que du type de brûlure. En général, si les brûlures touchent une surface de 5 à 6 % du corps, une hospitalisation n’est pas nécessaire. Entre 5 et 15 %, l’hospitalisation s’impose, mais il n’y aura pas automatiquement d’opération chirurgicale. Au-delà de 15 %, des soins intensifs sont incontournables et une insuffisance rénale peut se présenter.[2]
Les attaques à l’arme incendiaire telles que celles décrites dans les études de cas du présent rapport causent souvent des brûlures touchant bien plus de 15 % de la surface corporelle. Une fillette afghane âgée de 8 ans prénommée Razia, par exemple, a subi des brûlures touchant 40 à 45 % de sa surface corporelle à la suite d’une attaque au phosphore blanc menée en périphérie de Kaboul en 2009.[3] En 2013, dans la ville syrienne d’Urum al-Kubra, des enfants emmenés d’urgence à hôpital après une frappe à l’arme incendiaire sur leur école « ont subi des brûlures majeures couvrant 50, 60, 80 % de leur surface corporelle », selon la Dre Rola Hallam, médecin anglo-syrienne ayant participé à leur traitement.[4] La Dre Saleyha Ahsan, autre médecin d’urgence britannique postée dans cet hôpital, a déclaré à Human Rights Watch et à l’IHRC : « Chaque patient·e de mon groupe [de six] avait des brûlures sur plus de 60 % de sa surface corporelle. C’est énorme. C’est vraiment mauvais. Et nous savons que plus importante est la surface corporelle brûlée et plus jeunes sont les patient·e·s, moins bon est le pronostic ».[5] Les deux docteures ont expliqué qu’à taille égale et à exposition égale, les brûlures couvraient un pourcentage de surface corporelle plus important chez les enfants que chez les adultes.[6] Les enfants sont donc plus susceptibles de décéder de brûlures graves que les adultes. La Dre Ahsan a précisé : « [P]lus jeune est l’enfant et plus importante est la surface corporelle brûlée, plus faible est sa chance de survie. C’est très dangereux, chez les enfants ».[7]
Non seulement les brûlures infligées par des armes incendiaires touchent un pourcentage élevé de la surface corporelle, mais elles sont en plus profondes et dangereuses. « Les armes incendiaires provoquent des brûlures destructrices, bien plus graves qu’un ébouillantage ou qu’une brûlure par le feu classique », a précisé la Dre Hallam. « Ces flammes traversent tout. Si elles peuvent venir à bout de métal, quel espoir y a-t-il pour la chair humaine ? ».[8] Les personnes présentant des brûlures au napalm couvrant 10 % de leur surface corporelle peuvent développer une insuffisance rénale.[9] Une brûlure au phosphore blanc touchant 10 % de la surface corporelle peut entraîner le décès subit de la victime.[10]
Des jours, des semaines et des mois après avoir subi leurs brûlures, les survivant·e·s ont toujours besoin d’importants soins médicaux. Les victimes peuvent perdre d’énormes quantités de fluides à travers leurs plaies ouvertes.[11] La Dre Anupama Mehta, chirurgienne spécialiste des brûlures à l’hôpital Brigham and Women’s de Boston, dans le Massachusetts, a expliqué : « À partir d’une certaine taille de blessure, les patient·e·s nécessitent un volume important d’actes de réanimation. Cela signifie qu’il faut leur apporter des litres et des litres de liquide par simple hydratation pour faciliter le flux intravasculaire. C’est comme un sol sec qui a été entièrement brûlé : il faut lui apporter de l’eau ».[12] Cette déshydratation explique pourquoi les enfants blessés lors de l’attaque à l’arme incendiaire d’Urum al-Kubra demandaient continuellement de l’eau après leur arrivée à l’hôpital.[13] Le personnel médical doit également intuber les patient·e·s pour ouvrir leurs voies respiratoires et réaliser des soins intensifs sur les blessures, notamment des opérations visant à éliminer les peaux mortes.[14] Les brûlures compressent parfois tellement la poitrine qu’il devient difficile, voire impossible, de respirer. Dans ce cas, les médecins doivent inciser la chair pour libérer les mouvements de la poitrine.[15] Une fois leur état stabilisé, les victimes de brûlures graves subissent généralement de nombreuses greffes de peau pour remplacer les tissus disparus et accroître leurs chances de récupérer leur mobilité.[16] Ils ont également besoin de physiothérapie et d’ergothérapie pour récupérer leur force et leur amplitude de mouvement.[17]
Dès l’impact, pendant tout le traitement et même après le départ de l’hôpital, les brûlures provoquées par les armes incendiaires causent des douleurs insoutenables.[18] Les patient·e·s présentant des brûlures graves « ont besoin de prendre des doses maximales d’antidouleurs (...) une ou deux fois par jour », a rapporté la Dre Stephanie Nitzschke, chirurgienne au Brigham and Women’s Hospital, où elle dirige le centre de traitement des brûlures.[19] Si un ou une patient·e brûlé·e ne signale pas de sensation de douleur, comme dans le cas de nombreuses victimes de l’attaque d’Urum al-Kubra, cela « constitue un signal d’alerte immédiat qui donne une indication de l’étendue des brûlures », car cela signifie que les nerfs sont endommagés.[20] Même chez les patient·e·s qui ne ressentent pas initialement les effets de leurs brûlures, le traitement médical cause une douleur atroce. Les médecins et le personnel infirmier doivent retirer les tissus morts ou endommagés de la zone brûlée en employant une « méthode très douloureuse » appelée « débridement », et le changement des pansements, une ou deux fois par jour, pour minimiser le risque d’infection, « doit généralement être réalisé sous anesthésie ».[21]
Au cours des jours qui suivent l’apparition des brûlures, les survivant·e·s sont exposé·e·s à un risque élevé d’infection. La Dre Mehta a expliqué : « La peau est la première ligne de défense immunitaire, et si l’organe le plus étendu de l’immunité, la peau, est touché, alors, l’immunité naturelle est compromise ».[22] La perte de peau laisse « les blessures grand ouvertes, ce qui représente un réel risque d’infection. C’est la cause la plus commune de décès, lorsque les [patients·e·s] survivent à la phase initiale des 24 premières heures de la brûlure », a ajouté la Dre Nitzschke.[23] Lorsque les brûlures touchent plus de 20 pour cent de la surface corporelle, cela « accroît rapidement le risque d’infection » et peut entraîner un traumatisme, c’est-à-dire un état dans lequel le volume de sang circulant dans le corps diminue de façon brutale.[24]
Autres effets physiques et émotionnels
Les brûlures, quoiqu’étant les blessures les plus visibles, ne sont pas les seules infligées par les armes incendiaires. Dans de nombreux cas, l’exposition à ces armes endommage le système respiratoire. Les brûlures à la tête et au cou peuvent entraîner une inflammation des voies respiratoires supérieures qui entrave la respiration.[25] Ces armes libèrent en outre du monoxyde et du dioxyde de carbone, dont l’inhalation peut causer des empoisonnements ou des défaillances respiratoires ou organiques.[26] Respirer de l’air contenant des taux élevés de ces substances peut également altérer l’état mental.[27] Si l’attaque se produit dans un espace clos, les armes incendiaires peuvent engendrer une élévation de la température suffisante pour provoquer un accident cardiaque.[28]
Au-delà des blessures physiques, les armes incendiaires engendrent chez les survivant·e·s, les témoins et les familles des sentiments de peur, d’horreur et de panique.[29] Le 17 janvier 2009, Nimr al-Maqusi a été témoin d’une attaque au phosphore blanc visant l’école de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA) de Beit Lahiya, à Gaza, qui a tué deux enfants et blessé plusieurs autres. Il a raconté : « La scène dépassait tout ce qu’il est possible de décrire. Les gens couraient partout dans l’école, pris de panique ».[30] La Dre Ahsan a déclaré que les enfants qu’elle avait traités suite à l’attaque d’Urum al-Kubra « étaient terrifiés et en très grande souffrance », et leurs parents « profondément traumatisés ». Un homme « nous suppliait d’aider sa fille qui hurlait de douleur et appelait son père », s’est-elle souvenue. « Ces sons n’ont pas quitté mes oreilles... C’était épouvantable. »[31]
Le phosphore blanc
Bien qu’il ne soit pas inclus dans la définition des armes incendiaires figurant au Protocole III de la CCAC, le phosphore blanc est connu pour la gravité des blessures qu’il cause. « Les brûlures provoquées par le phosphore blanc sont bien plus létales que les brûlures ordinaires », selon Donatella Rovera, conseillère principale sur la réaction aux crises à Amnesty International, qui a couvert les attaques au phosphore blanc à Gaza en 2009.[32] Il suffit que 10 à 15 pour cent de la surface corporelle d’une personne soit touchée pour que ces blessures puissent entraîner une mort subite.[33] Comme elles sont également particulièrement profondes, souvent jusqu’aux os, la cicatrisation est plus longue que pour d’autres types de brûlures.[34] Les photographies de Razia prises à son arrivée à l’hôpital de la base aérienne de Bagram montrent que le phosphore blanc a transpercé son cuir chevelu pour atteindre son crâne ; il a également brûlé certains nerfs et ses cheveux.[35] De même, à la simple vue de la profondeur des blessures de l’homme qu’il était en train de traiter, le Dr Nafiz Abu Sha’ban, de l’hôpital al-Shifa, à Gaza, a su que les brûlures avaient été causées par du phosphore blanc.[36]
Même lorsqu’il peut sembler que le personnel médical maîtrise les dangers immédiats du phosphore blanc, en réalité, ce n’est souvent pas le cas. Le phosphore blanc peut coller au visage, comme cela a été le cas pour Razia, ou continuer de brûler à l’intérieur du corps et aggraver les brûlures initiales avec le temps.[37] À l’issue du traitement d’un survivant d’une attaque au phosphore blanc, à Gaza, le Dr Abu Sha’ban a déclaré à Human Rights Watch : « Nous avons déjà excisé les tissus brûlés, mais maintenant, ses blessures s’aggravent. Lorsque nous l’avons vu pour la première fois, ses blessures étaient plus superficielles qu’elles ne le sont maintenant. Nous devons le réopérer demain pour enlever plus de tissus ».[38] À cause de leur gravité et de leur capacité à continuer de brûler à l’intérieur du corps, les brûlures infligées par le phosphore blanc nécessitent généralement des séjours plus longs à l’hôpital que les autres types de brûlures couvrant un pourcentage semblable de la surface corporelle.[39]
Si le phosphore blanc n’est pas complètement éliminé, la portion restante peut se réactiver après le traitement, car l’exposition à l’oxygène fait brûler cette substance. Étant donné que le phosphore blanc passe dans le système digestif, il cause même des « selles fumantes » chez les patient·e·s.[40] « Pour se débarrasser [du phosphore blanc], il faut littéralement aller l’enlever. Il faut littéralement l’enlever chirurgicalement », a indiqué Christine Collins, ancienne capitaine des Forces militaires aériennes des États-Unis et infirmière en soins intensifs qui a soigné Razia.[41]
Les dangers du phosphore blanc vont au-delà de son pouvoir de brûlure. Toxique pour l’humain, il peut s’infiltrer dans le système sanguin à travers la peau et empoisonner les reins, le foie et le cœur, et causer de multiples défaillances organiques.[42] Une simple inhalation peut causer la mort.[43] Les émanations qui se dégagent lors d’attaques peuvent également blesser ou gravement irriter les yeux et les rendre fortement sensibles à la lumière.[44] Enfin, l’exposition à cette substance peut causer des paralysies faciales[45], des crises d’épilepsie[46] et des troubles fatals du rythme cardiaque.[47]
Les personnes qui survivent aux blessures initiales causées par des armes incendiaires endurent des souffrances toute leur vie. « Malheureusement, pour les patient·e·s [brûlé·e·s], c’est une bataille sans fin, surtout lorsque les [brûlures sont particulièrement étendues] », a précisé la Dre Mehta, du Brigham and Women’s Hospital.[48] La Dre Hallam, médecin britannico-syrienne qui a traité les victimes de l’attentat d’Urum al-Kubra, a indiqué que les brûlures infligées par des armes incendiaires, en particulier, « tuent généralement sur le coup ou assez rapidement. Les survivant·e·s se retrouvent avec d’immenses handicaps et doivent faire l’objet d’une attention et de soins médicaux continus ».[49] Parmi les blessures physiques à long terme figurent les douleurs chroniques, les dommages cutanés, les cicatrices et des handicaps physiques, visuels, auditifs, etc. Les effets psychologiques et socioéconomiques exacerbent en outre les dommages subis par les survivant·e·s et leurs familles.
Douleurs chroniques et dommages cutanés
Les victimes d’armes incendiaires ressentent souvent une douleur intense, à long terme.[50] Kim Phuc Phan Thi, la fillette vietnamienne immortalisée dans le célèbre cliché de Nick Ut alors qu’elle fuyait une attaque au napalm en 1972, a indiqué par la suite avoir subi des douleurs intenses des décennies durant, après sa blessure initiale.[51] Lors d’un examen médical réalisé en 2015, plus de quatre décennies plus tard, « il était évident que le napalm enflammé retombé sur son épaule gauche avait causé des brûlures couvrant à peu près 40 pour cent de son corps, suscitant des douleurs quotidiennes qu’elle évaluait encore à 10 » sur une échelle de 1 à 10. La douleur ne s’est atténuée qu’après une série de traitements au laser qui ont suivi cet examen.[52] De plus, outre le traumatisme qu’elle inflige, la douleur peut perturber le sommeil.[53]
Les victimes souffrent également d’effets à long terme de dommages cutanés pouvant engendrer une sécheresse excessive et soit de l’hypersensibilité, soit la perte de sensation. Christine Collins, infirmière référente de Razia, a indiqué que les armes incendiaires peuvent détruire les glandes sébacées et les minuscules poils de la peau, qui devient alors comme « un morceau de papier dépourvu de la capacité de se protéger ».[54] Les patient·e·s doivent dès lors passer beaucoup de temps à suivre une longue routine de soins consistant à hydrater fréquemment leur peau. [55] Les victimes de brûlures peuvent également être sensibles au froid ou à la chaleur.[56] Une étude de 2020 sur les survivant·e·s de brûlures a montré qu’une majorité de patient·e·s indiquaient que leur peau était devenue « plus sensible à la chaleur après [avoir subi les brûlures] ».[57] Les patient·e·s présentant de graves brûlures perdent souvent leurs glandes sudoripares. Par conséquent, il est plus difficile, pour leur corps, de réguler sa température, a expliqué le Dr Jeffrey Schneider, directeur de programme du système de modélisation des blessures par brûlure de l’université de Harvard à Boston et directeur médical du programme sur les brûlures et les traumatismes de l’Hôpital de rééducation de Spaulding.[58] Dans la plupart des cas graves, les patient·e·s perdent certaines sensations en raison de la perte de terminaisons nerveuses.[59] D’autres effets sont à noter : la décoloration de la peau[60] et un « risque à long terme de lésions cutanées malignes sur les parties qui ont été brûlées ».[61]
Handicaps, notamment physiques, et cicatrices
Les brûlures provoquées par des armes incendiaires causent également des handicaps durables et d’importantes cicatrices. Selon une étude récente, le napalm engendre généralement des handicaps physiques en raison de la perte de mobilité des parties touchées du corps de la victime, et les survivant·e·s doivent souvent suivre une importante thérapie de rééducation.[62] Le tissu cicatriciel et les greffes de peau, si elles sont insuffisantes, entraînent des contractures qui entravent le mouvement, la taille des muscles et des articulations étant réduite. Des kystes peuvent également se développer sur les articulations ou les os des mains et limiter la mobilité.[63] Christine Collins a commenté : « Ce sont toutes ces choses que la plupart des gens tiennent pour acquises : la capacité de se pencher en avant [ou] en arrière ».[64] La Dre Nitzschke a expliqué : « Nous considérons que les patient·e·s gravement brûlés, en particulier, sont des patient·e·s à vie. Ils auront besoin d’interventions ici et là, à mesure que nous traitons leurs contractures ».[65] Les contractures peuvent être traitées par physiothérapie ou par des interventions chirurgicales lorsque les patient·e·s ont accès à des soins de santé de qualité, mais dans les zones de conflits armés, ces occasions sont limitées.
Les brûlures à la tête, au cou et au visage présentent des difficultés supplémentaires pour les victimes de brûlures. Lorsque le visage est touché, les cellules mortes et le pus peuvent générer des « abcès causant une douleur insupportable » dans les voies nasales et auriculaires.[66] Les survivant·e·s de brûlures à la tête et au cou ont parfois du mal à déglutir et à parler[67] et peuvent avoir besoin de suivre une thérapie de rééducation pour réapprendre à manger.[68] Les brûlures directes aux yeux peuvent entraîner la perte d’un ou des deux yeux,[69] et une sécheresse oculaire chronique, comme cela a été le cas pour Razia, et devenir un problème permanent. Ces brûlures peuvent altérer le goût, l’odorat, l’audition et la vue, autrement dit, les sens qui garantissent l’expérience la plus basique du monde.[70]
Des effets disparates sur les enfants
Les enfants, dont le corps est en cours de développement, sont particulièrement vulnérables aux conséquences sur le long terme des brûlures causées par les armes incendiaires. Leur croissance peut être freinée par la perte d’élasticité de la peau, dont la malléabilité est réduite du fait des contractures. La peau des enfants victimes de brûlures causées par une arme incendiaire se contracte fortement à mesure qu’ils grandissent. La Dre Hallam a comparé le développement des contractures au fait d’avoir un « bandage serré » autour du corps, qui empêche ce dernier de s’étirer et de poursuivre sa croissance.[71] Bien qu’une certaine flexibilité soit préservée, il en résulte cependant, selon elle, « un handicap plus important que si la croissance avait déjà été achevée ».[72]
Dommages cognitifs et psychologiques
Les blessures physiques associées aux armes incendiaires sont intrinsèquement dévastatrices, mais elles sont également inextricablement liées à des dommages cognitifs et psychologiques. Selon les expert·e·s, les brûlures peuvent engendrer des handicaps, notamment physiques, durables et ont « un impact tout au long de la vie » sur la santé psychologique.[73]
Les dommages cérébraux associés aux brûlures graves sont liés à l’état de choc physiologique causé par une perte très importante de fluides. « La tension sanguine [baisse fortement], engendrant des répercussions sur les organes vitaux, dont le cerveau. Par conséquent, si la victime reste longtemps sur place sans recevoir les soins de réanimation nécessaires, notamment la perfusion intraveineuse de liquides, des [blessures cérébrales] peuvent se produire », a expliqué le Dr Schneider.[74] Les victimes de brûlures peuvent également souffrir de blessures hypoxiques, surtout si elles se trouvent dans un espace clos au moment où la brûlure se produit. Ces blessures, qui entraînent une baisse du niveau d’oxygène dans les voies sanguines, peuvent avoir des incidences à long terme sur les capacités cognitives.[75]
Les problèmes de santé mentale associés aux brûlures sont entre autres l’anxiété, la dépression, les troubles du stress post-traumatique et les sentiments d’abattement, d’impuissance et de solitude. Selon la Dre Nitzchke, l’angoisse et la dépression sont particulièrement courantes chez les survivant·e·s.[76] L’angoisse peut trouver sa source à la fois dans le traumatisme de l’incident ayant causé les brûlures, et dans la peur de devoir subir un traitement douloureux.[77] « L’angoisse de devoir suivre [un traitement] tout en sachant qu’il faudra le suivre chaque jour peut être à l’origine de quantité de problèmes de santé mentale qui se manifestent par la suite », a-t-elle précisé.[78] Cette angoisse peut à son tour accentuer la douleur.[79]
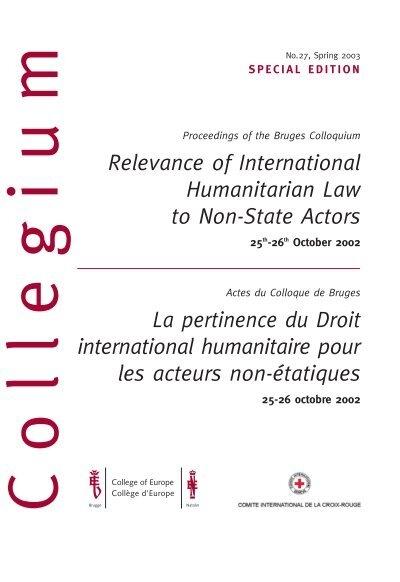
Les cicatrices persistantes que laissent les brûlures causées par des armes incendiaires, en particulier au visage ou sur d’autres parties visibles du corps, peuvent également engendrer une détresse émotionnelle.[80] Une étude a démontré que « la douleur résultant d’une expérience dévastatrice, les déficiences fonctionnelles et esthétiques, et l’altération de l’image de son propre corps et de la fonction sociale ont une incidence négative sur l’essence même des patient·e·s, en particulier leur image de soi ».[81] Les handicaps subis par les victimes peuvent les amener à « se sentir plus dépendants d’autrui ou avoir l’impression d’être un fardeau. À cause de l’impression d’incapacité ou d’impuissance, on peut s’attendre à ce que certain·e·s survivant·e·s [de brûlures] développent progressivement le désir de mourir ou de se suicider ».[82] La Dre Schneider a ajouté que généralement, l’impact psychologique est disproportionné chez les patient·e·s présentant des problèmes préexistants de santé mentale ou qui ne bénéficient pas d’un soutien psychosocial suffisant.[83] Par rapport aux victimes de brûlures ordinaires, les survivant·e·s qui se trouvent dans des zones de conflit rencontrent davantage de difficultés en raison de la rareté des ressources et d’un accès limité aux opérations de chirurgie esthétique susceptibles de réduire les conséquences liées à la cicatrisation.
Les cicatrices de brûlures peuvent perturber de façon disproportionnée la santé mentale des femmes et des filles et limiter les possibilités qui se présentent à elles dans la vie.[84] Christine Collins et Rahim Faiez, reporter à l’AP, tous deux restés en contact avec Razia, se disent préoccupés par ses faibles perspectives de mariage, dans une culture afghane où celui-ci est particulièrement valorisé.[85] En octobre 2020, Aziz, père de Razia, a confié à Rahim Faiez sa crainte que personne n’épouse sa fille, qui vit toujours chez ses parents.[86] Les femmes étant soumises à des attentes plus élevées sur le plan de la beauté[87], ces brûlures peuvent avoir des conséquences particulièrement négatives sur leur santé mentale. Une autre étude a montré que « les femmes sont plus vulnérables face aux conséquences de la défiguration », et que « l’incidence plus élevée des symptômes de dépression chez les femmes est liée à l’altération de l’image qu’elles ont de leur corps ».[88]
Les cicatrices laissées par les brûlures graves peuvent entraver le développement des enfants. « Durant leur développement, les enfants acquièrent leur personnalité et définissent leur place dans le monde », a expliqué le Dr Schneider. « Avoir une particularité [d’importantes cicatrices, par exemple] qui modifie la façon dont ils se sentent, en tant que personne, et altère leur confiance en soi et leur façon d’interagir avec les autres enfants peut les marquer profondément ».[89]
Les armes incendiaires peuvent également avoir des répercussions négatives sur la santé émotionnelle et psychologique des équipes médicales qui soignent les victimes. Dans leurs entretiens avec Human Rights Watch et l’IHRC, les médecins et les infirmier·ère·s qui ont traité des blessures causées par des armes incendiaires ont toutes et tous rapporté avoir des souvenirs récurrents de cette expérience.[90] La Dre Hallam a précisé : « Cet événement est vraiment gravé dans mon cœur, dans mon esprit et dans mon âme, car je n’avais jamais été témoin d’une telle chose et cela ne s’est pas reproduit depuis lors ».[91] La Dre Ahsan, indiquant que les élèves ayant survécu à l’attaque d’Urum al-Kubra souffraient probablement de troubles du stress post-traumatique, a ajouté : « Je pense en souffrir moi aussi, depuis cet événement, du simple fait d’avoir travaillé à cet endroit en tant que médecin ».[92] Envoyée en mission en Bosnie aux côtés de l’armée britannique, elle a également passé huit mois en Libye, mais selon ses dires, « la Syrie est un cas à part parmi tout ce que j’ai vu et dont j’ai été témoin ».[93]
Conséquences sociales et économiques
Les dommages physiques et psychologiques décrits ci-dessus peuvent créer des obstacles à l’inclusion sociale pour les survivant·e·s d’attaques à l’arme incendiaire. La Dre Nitzchke a expliqué que « le fait que des zones esthétiquement sensibles soient touchées, la profondeur des brûlures, qui cause des contractures et [réduit la mobilité], et la surface corporelle totale touchée sont les principaux facteurs expliquant que les personnes brûlées sont susceptibles de ne pas retrouver une vie sociale ».[94] Selon le Dr Schneider, les brûlures et les cicatrices peuvent compromettre en profondeur la capacité d’un survivant·e à « entrer en contact avec le monde qui l’entoure ».[95] Le Dr Schneider et son équipe du Système de modélisation des brûlures de l’Université d’Harvard, à Boston, ont mis au point l’outil « LIBRE », qui permet d’évaluer la participation sociale des survivant·e·s de brûlures en examinant six domaines où cette participation est perturbée en raison des brûlures : les interactions avec la famille et les amis, les relations sexuelles, les relations sentimentales, les activités sociales, les interactions sociales, et le travail et l’emploi.[96]
Les survivant·e·s présentant des brûlures sur des zones exposées de leur corps, surtout le visage et les mains, connaissent des difficultés particulières. La Dre Hallam, qui a traité les enfants brûlés lors de l’attaque d’Urum al-Kubra, a précisé : « Ces cicatrices sont très visibles et ont quelque chose de spontanément repoussant pour de nombreuses personnes. C’est pourquoi beaucoup [de survivant·e·s] sont ostracisé·e·s et tenu·e·s à l’écart. Il y a souvent de l’isolement social, outre le sentiment de culpabilité du survivant, et la mentalité victimaire qui consiste à se demander “Pourquoi moi ? Pourquoi nous ?” ».[97] Le Dr Schneider souligne que souvent les victimes de brûlures « évitent les autres. Elles restent chez elles et ne sortent pas. Elles évitent d’interagir avec des inconnu·e·s. Tous ces comportements sont des problématiques silencieuses dont les gens n’ont pas toujours connaissance ».[98] Ces difficultés sociales peuvent avoir des conséquences sévères sur la qualité de vie des survivant·e·s.[99]
Les brûlures causées par les armes incendiaires peuvent entraver l’éducation des enfants. Il peut être physiquement dangereux, pour eux, de retourner à l’école si leurs blessures ne sont pas encore cicatrisées, car celles-ci risqueraient de s’infecter.[100] De plus, les enfants présentant des cicatrices visibles peuvent hésiter à y retourner par peur du regard des autres élèves. À cause de ses blessures, Razia « ne voulait pas retourner à l’école. Elle ne voulait pas qu’on la harcèle ».[101] Malgré l’attitude aimante et bienveillante de sa famille, elle n’a pas appris à lire.[102] Sur le plan scolaire, pour que les enfants brûlés puissent être sur un pied d’égalité avec les autres élèves, des adaptations ou des modifications raisonnables sont souvent nécessaires. Dans les zones de conflits, ces adaptations, qui peuvent être des aménagements de la salle de classe, des pauses durant la journée, des supports de travail faciles à lire ou un soutien socio-émotionnel, sont pratiquement inexistantes, ce qui rend le retour à l’école de ces enfants très difficile, voire impossible. « Il est crucial, pour la guérison définitive [d’un enfant] », que celui-ci ait accès à des programmes éducatifs adaptés en fonction de ses blessures, et qu’il soit accompagné pour surmonter ces difficultés, a souligné le Dr Schneider.[103] « Dans des pays tels que les États-Unis, a‑t‑il poursuivi, les écoles ont l’obligation de répondre à certains besoins. Les centres de soins des personnes brûlées le savent et peuvent plaider en la faveur des enfants survivants, et par conséquent, il existe des programmes pour les aider à retourner à l’école ».[104] Malheureusement, il y a peu de chances que de tels programmes soient en place dans des lieux où la réalité des conflits armés limite fortement la capacité des communautés à répondre aux besoins des enfants survivants.
Les survivant·e·s et leurs familles peuvent subir les effets économiques des armes incendiaires. Les blessures peuvent créer des obstacles à l’emploi. Nombre de survivant·e·s brûlé·e·s ne sont pas en mesure de reprendre l’emploi qu’ils occupaient auparavant ou ne peuvent en trouver un autre ; ils peuvent également être confrontés à la stigmatisation de la part des employeurs.[105] La dépression, le traumatisme et l’angoisse peuvent éroder l’intérêt ou la motivation professionnels.[106] Le coût des traitements réguliers peut également épuiser leurs ressources financières.
Les armes incendiaires peuvent en outre endommager les biens. En janvier 2009, par exemple, des obus de phosphore blanc ont touché le siège des Nations Unies à Gaza, et l’attaque a « pratiquement complètement détruit une importante réserve d’aliments et de médicaments (...) L’impact a été massif ».[107] Donatella Rovera, d’Amnesty International, a précisé : « Il ne faut pas sous-estimer les dommages que les [incendies provoqués par le phosphore blanc] causent aux biens, ni le niveau de destruction qui en découle ».[108] Il a également été fait état d’armes incendiaires brûlant des terres agricoles en Syrie.[109]
Les brûlures causent non seulement toute une série de dommages physiques, psychologiques et socioéconomiques, mais elles sont également particulièrement difficiles à traiter. Immédiatement après avoir été brûlées, les victimes de brûlures très graves ont souvent besoin de « litres et de litres de fluides », de tuyaux respiratoires, de traitements antidouleur et de sédatifs, ainsi que de sondes gastriques.[110] Les médecins doivent également veiller à éviter les infections, les chocs et les défaillances organiques.[111] Le traitement à long terme des victimes de brûlures, qui suppose de multiples opérations chirurgicales, des séances de physiothérapie et des soins psychologiques, est décrit comme « l’un des pans les plus complexes, longs et coûteux de la médecine de rééducation ».[112]
Dans les contextes civils, en particulier dans les pays développés, ces traitements médicaux, quoique complexes, sont généralement accessibles aux patient·e·s brûlé·e·s. Cependant, les armes incendiaires sont utilisées dans des situations de conflit armé, un environnement où les obstacles aux soins sont démultipliés. L’étude réalisée par Bishara S. Atiyeh, S.W.A. Gunn et Shady Hayek propose cette distinction :
La Dre Hallam, décrivant la réponse médicale apportée suite à l’attaque aux armes incendiaires à Urum al-Kubra, a souligné que les personnes vivant dans des zones de conflit « n’ont tout simplement pas le luxe d’avoir à disposition un système de soins de santé en état de fonctionnement ».[114] Les attaques menées contre les infrastructures de soins de santé, largement attestées dans le conflit syrien, exacerbent les problèmes de traitement des victimes d’armes incendiaires.[115]
Pénuries de ressources et obstacles au transport de victimes
Dans les zones de conflit, les prestataires de soins de santé disposent souvent d’un accès limité aux fournitures, au matériel et aux installations de soins intensifs nécessaires pour traiter adéquatement les brûlures provoquées par des armes incendiaires. Ces restrictions peuvent entraver la capacité des médecins, même très compétent·e·s, à fournir des soins adéquats à ces patient·e·s. La Dre Hallam a été confrontée à ce type de difficultés alors qu’elle traitait les victimes de l’attaque d’Alep, en 2013. Elle a raconté à Human Rights Watch et à l’IHRC : « Je savais, en tant que médecin spécialisée en soins intensifs, ce qu’il fallait faire pour [soigner] ces enfants, mais je n’avais pas le matériel nécessaire. J’avais l’expertise et les connaissances qui m’auraient permis de [prodiguer des soins adéquats], mais pas le matériel et les ressources nécessaires. Au lieu de cela, ils ont reçu des traitements terriblement inadéquats ».[116] Si elle disposait de ressources médicales limitées, elle a cependant précisé qu’« ailleurs en Syrie, ils n’ont même pas l’expertise pour gérer [une telle attaque] ».[117]
La médiocrité des infrastructures, la nécessité de se déplacer loin pour trouver des soins de santé appropriés et l’absence de moyens de transport médicalisés sont autant d’écueils empêchant de fournir des soins essentiels aux victimes d’armes incendiaires au cours des 24 premières heures, qui sont cruciales.[118] Il faut souvent compter sur les amis, le voisinage et les passants pour emmener ces dernières dans les centres de soins.[119] La Dre Ahsan, qui a travaillé avec la Dre Hallam après l’attaque d’Urum al-Kubra, s’est souvenue : « Les patient·e·s étaient amenés par tous les moyens possibles ».[120] Une fois leur état stabilisé par l’administration de fluides et d’antidouleurs, ils étaient emmenés de l’autre côté de la frontière, dans des hôpitaux turcs, au terme d’un voyage d’environ six heures. La Dre Hallam a rapporté :
Un personnel médical limité
Les pénuries de personnel médical accentuent également les dommages provoqués par des armes incendiaires. Avant ou pendant le transport vers des centres de soins de santé, la vaste majorité des victimes de brûlures infligées dans le cadre d’un conflit reçoivent généralement « une forme ou une autre de premiers secours administrés par les membres de leur famille, des amis, ou des premiers répondants non formés pour de telles interventions ».[122] Comme ces derniers ne sont habituellement pas des spécialistes des soins des brûlures, leur priorité « ne porte pas sur la stabilisation, mais plutôt sur l’évacuation vers le lieu où les soins seront en définitive prodigués ».[123]
Dans les zones de conflit, les hôpitaux comptent peu de médecins, et encore moins de professionnels dûment formés pour soigner correctement les patient·e·s brûlé·e·s. En Syrie, par exemple, la Dre Hallam souligne que l’État est loin d’avoir atteint le minimum d’effectifs fixé par l’Organisation mondiale de la Santé, qui est de 23 soignant·e·s pour 10 000 personnes, pour les services pédiatriques.[124] « Dans de nombreuses zones de conflit, les services de soins des brûlures sont basiques et limités, et il n’y a souvent pas de spécialiste sur place », a indiqué la Dre Ahsan.[125] Cette réalité est particulièrement préoccupante, car les brûlures complexes nécessitent généralement « une démarche multidisciplinaire dans laquelle la stabilisation, la reconstruction et le processus de rééducation sont soigneusement répartis entre spécialistes des brûlures, personnel infirmier, thérapeutes, services sociaux, et autres services de soutien ».[126] De plus, le nombre excessif de blessé·e·s, commun dans les situations de conflit armé, peut engendrer des engorgements dans le processus de traitement.[127] Ces engorgements, à leur tour, peuvent placer les professionnels face à l’obligation d’effectuer un tri difficile.[128]
Les médecins disposant de l’expertise requise n’ont souvent pas accès aux informations leur permettant de reconnaître les brûlures spécifiquement causées par des armes incendiaires. La Dre Hallam a décrit le désarroi de son équipe à l’arrivée des premier·ère·s patient·e·s à l’hôpital d’al-Atarib : « Nous ignorions à quoi nous avions affaire, car nous n’avions aucune information. [Les enfants] étaient simplement couverts d’une poussière blanche bizarre, leur peau était brûlée, et [il y avait] une odeur synthétique dans l’air ; nous ne savions donc pas ce qu’il se passait ».[129] Donatella Rovera a décrit une confusion initiale semblable chez les médecins qui ont traité les victimes de l’attaque au phosphore blanc de 2009 à Gaza. « Aucun de ces médecins n’avait jamais eu à traiter [de brûlures provoquées par du phosphore blanc] ; ils étaient dans une totale ignorance. [Au départ,] ils ont traité [les brûlures] comme s’il s’agissait de brûlures classiques et à cause de cela, ils ont perdu un temps précieux ».[130] Ce manque d’information et de compréhension peut nuire au traitement des victimes, car « la bonne gestion des brûlures, au cours de conflits armés, commence par une bonne compréhension des mécanismes de la blessure et des propriétés et caractéristiques des agents l’ayant provoquée ».[131]
Continuité des soins
La discontinuité des soins crée souvent des problèmes supplémentaires pour les victimes d’armes incendiaires. Souvent, plusieurs médecins interviennent durant la phase aiguë de traitement et les soins prodigués sont mal consignés, c’est pourquoi il est difficile, pour les soignant·e·s qui prennent le relais de discerner quels autres domaines problématiques doivent être traités.[132] La nature fragmentée de la communication entre les différents prestataires de soins de santé, « à différents échelons de soins », brouille le suivi des progrès du traitement.[133]
La continuité des soins est également importante pour prendre en charge « les problèmes médicaux chroniques » associés aux brûlures. Selon le Dr Schneider, « ces problèmes ne disparaissent pas aisément. [Généralement, les survivant·e·s de brûlures] sont des patient·e·s à long terme qui se retrouvent à devoir être suivis très longtemps par une équipe clinique ».[134] Les victimes d’armes incendiaires qui restent dans les zones de conflit armé ont peu de chance d’avoir accès à des soins et un suivi réguliers de ce type.
Soins des autres blessures
Dans les zones de conflit, en général, les professionnels des soins de santé doivent traiter de nombreux autres types de blessures. Les brûlures infligées par des armes incendiaires ne sont « sans doute pas l’unique choc » nécessitant une attention médicale.[135] Donatella Rovera a expliqué que les soignant·e·s qui se trouvaient à Gaza en 2009 « avaient atteint la limite de leurs capacités, car ils ne se contentaient pas de soigner les [brûlures dues aux armes incendiaires] (...) [Le système de soins de santé] était mis à mal à l’extrême à cause du niveau global du conflit ».[136] Les brûlures sont en outre considérées comme une « blessure distrayante », car leur traitement peut faire obstacle à l’identification et au diagnostic de blessures secondaires.[137]Par exemple, le « traitement par narcotiques des douleurs secondaires, par rapport aux brûlures, peut compliquer considérablement le diagnostic des blessures qui leur sont associées, telles que les blessures médullaires ».[138]
Une moindre attention est portée aux dommages psychologiques associés aux armes incendiaires, par rapport à celle portée aux dommages physiques aigus. La Dre Hallam a développé : « Dans les soins des brûlures, la thérapie [psychologique] est importante, car la santé mentale et l’effet traumatique des brûlures constituent un aspect considérable de [ces blessures] ».[139] À cause du niveau de gravité des blessures physiques que peuvent causer les guerres, cependant, le soutien psychologique passe souvent au second plan et est insuffisamment financé dans les zones de conflit armé.[140] Le traitement de ces patient·e·s est donc très incomplet, car cet aspect majeur de leurs soins médicaux n’est pas pris en compte.
Changer la donne pour les civils en situation de conflit
Tous ces facteurs jouent un rôle dans les disparités marquant les niveaux de soins des brûlures et leur issue, selon que l’on se trouve en milieu civil ou dans les environnements de combat. Cela génère une réelle frustration parmi le personnel médical qui soigne les victimes d’armes incendiaires. « Les [armes incendiaires] causent des handicaps profonds et permanents, et le système médical [syrien] n’est pas équipé pour les prendre en charge. Nombre de [survivant·e·s] doivent vivre avec des handicaps qui, dans un autre contexte, pourraient être soignés. Leurs handicaps sont plus importants que ceux d’autres personnes se trouvant dans une situation semblable, mais vivant ailleurs », a déploré la Dre Hallam.[141] La Dre Ahsan partage ce sentiment : « Je me souviens avoir pensé : “Mon Dieu, j’aimerais tant pouvoir soigner cet enfant dans mon hôpital, à Londres. Ce serait tellement différent si je pouvais juste les soulever de leur lit et les emmener tout de suite, à l’instant” (...) J’étais furieuse et dégoûtée ».[142]
Des effets sur le personnel médical
Les effets des armes incendiaires mettent également le personnel médical en danger. Étant donné la tendance du phosphore blanc à reprendre sa combustion, lorsque les soignant·e·s retirent les pansements, des flammes peuvent jaillir des blessures encore porteuses de cette substance.[143] Un article du journal The Lancet a décrit le cas d’un homme de 18 ans admis à l’hôpital après l’attaque au phosphore blanc de 2009. Lorsque les soignant·e·s ont découvert la fumée blanche « émanant de [ses] blessures », ils l’ont transféré en salle d’opération pour nettoyer les blessures et enlever les peaux mortes qui les entouraient.[144] Une particule de phosphore délogée au cours de cette procédure est venue brûler le cou d’un infirmier.[145] D’autres substances incendiaires, dont le napalm, peuvent provoquer une élévation des températures à un tel niveau qu’elles nuisent à la santé non seulement des victimes directes, mais aussi des sauveteur·euse·s, dès lors susceptibles de subir une attaque cardiaque.[146] Enfin, comme cela a été précisé plus haut, l’expérience du traitement de victimes d’armes incendiaires peut être traumatique pour les soignant·e·s.
Trois études de cas réalisées à Gaza, en Afghanistan et en Syrie illustrent le coût humain de l’utilisation d’armes incendiaires. Elles décrivent les terribles blessures infligées aux personnes, leurs effets durables sur le plan physique et mental, et les longs traitements requis pour soigner les victimes. Ces dommages inacceptables sont semblables qu’ils soient causés par des munitions au phosphore blanc, des armes incendiaires couvertes par le Protocole III, des armes lancées depuis le sol ou des armes larguées par aéronef.
Gaza 2009 : la famille Abu Halima
Le 4 janvier 2009 après-midi, trois obus d’artillerie au phosphore blanc de 155 mm tirés par les forces armées israéliennes dans le contexte d’hostilités avec des groupes armés palestiniens ont traversé le toit de la maison de la famille Abu Halima, à Sifi, une zone proche de Beit Lahiya, dans le Nord de la bande de Gaza.[147] Plus d’une dizaine de membres de cette famille, âgés de 6 mois à 45 ans, se trouvaient chez eux au moment de l’attaque, notamment Sa’dallah et Sabah Abu Halima, âgés respectivement de 45 et 44 ans, neuf enfants, une belle-sœur et deux petits-enfants.[148] Ahmad Abu Halima, fils de 22 ans de Sa’dallah et Sabah, a rapporté : « L’explosion a été très forte, et l’odeur insupportable. Cela a provoqué un grand incendie. Des bouts (...) de phosphore blanc brûlaient et nous ne parvenions pas à les sortir ».[149] Muhammad, fils de 24 ans du couple, a raconté : « Nous avons crié et hurlé, et appelé nos voisins à l’aide, mais personne ne pouvait s’approcher pour nous secourir, parce que l’armée israélienne se trouvait à environ 100 mètres et tirait sur tous ceux qui approchaient ».[150]
Les retombées de cet épisode illustrent les importants dommages physiques et psychologiques causés par le phosphore blanc et l’utilisation d’armes incendiaires sol-air dans des milieux abritant une concentration de civils. L’étude de cas repose sur des recherches menées sur le terrain au moment des faits et dix ans plus tard par Human Rights Watch, Amnesty International et B’Tselem, une ONG israélienne de défense des droits humains.
Cinq membres de la famille Abu Halima sont décédé·e·s dans l’attaque, brûlé·e·s vifs et vives dans l’incendie provoqué par des morceaux de feutre imprégnés de phosphore blanc. Muhammed a raconté avoir trouvé les corps complètement carbonisés de son père et de ses frères Abd a-Rahim, 14 ans, Zeid, 11 ans et Hamzah, 10 ans.[151] Sabah était en train d’allaiter sa fille de 15 mois lorsque tout s’est enflammé. Elle a raconté : « Mon mari et quatre de mes enfants ont brûlé vifs sous mes yeux, mon bébé... mon unique fille, a fondu dans mes bras. Comment est-il possible qu’une mère doive voir ses enfants brûler vifs ? Je n’ai pas pu les sauver. Je n’ai pas pu les aider ».[152]
Les flammes émanant du phosphore blanc ont mis feu aux vêtements de l’épouse de Muhammed, Ghada, 21 ans et de leur fille de 2 ans, Farah. Dans un entretien accordé à B’Tselem à l’hôpital d’al-Shifa cinq jours après l’attaque, Ghada a raconté : « J’ai arraché les vêtements de mon corps et j’ai hurlé que j’étais en train de brûler. J’étais nue devant tout le monde dans la maison (...) La douleur était atroce. Je pouvais sentir l’odeur de ma chair qui brûlait ».[153] L’étendue des blessures était importante et couvrait probablement une surface corporelle élevée. Ghada a indiqué que « tout son corps était brûlé ».[154] Muhammad a indiqué par la suite à B’Tselem que Ghada avait été transférée vers un hôpital égyptien où elle a « reçu une série de traitements — opérations chirurgicales, désinfection des brûlures et greffes de peau ».[155] Ghada est décédée près de trois mois après l’attaque. Les médecins ont expliqué à Mohammad qu’« une interaction en chaîne avait été déclenchée dans son corps par le phosphore [blanc], et que ses cellules avaient arrêté de fonctionner ». [156]
Plusieurs autres membres de la famille ont également été gravement brûlés. Les fils de Sa’dallah et de Sabah, Yusef, 16 ans, et Ali, 5 ans, ont été brûlés au visage et dans le dos respectivement.[157] Farah, leur petite-fille, aurait présenté des brûlures du troisième degré.[158] Selon le Dr Alaa Ali, de l’unité de soins des personnes brûlées de l’Hôpital d’al-Shifa, Sabah elle-même présentait des « brûlures très profondes touchant l’os, le brûlant même à certains endroits ».[159] Peu de temps après l’attaque, Sabah a d’ailleurs raconté à Amnesty International : « J’étais en feu. Encore maintenant, je brûle de partout, je souffre jour et nuit, je souffre terriblement ».[160]
Cet épisode a également marqué les survivant·e·s sur le plan émotionnel et psychologique. « Voir ma famille dans cet état, c’était terrifiant », a confié Muhammad à B’Tselem une décennie plus tard.[161] « Les horribles souvenirs sont toujours présents, en particulier la vision de ma petite sœur Shahd, qui était bébé... Qu’est-ce qu’elle a fait pour être tuée de cette façon ? C’était notre seule sœur. Je me souviens de la joie que nous avons tous ressentie lorsque ma mère a enfin mis une fille au monde. Je me souviens que ma mère avait pleuré de joie. J’aimerais que Shahd soit avec moi maintenant. J’aurais pu avoir une sœur, comme les autres, j’aurais pu jouer et rire avec elle, lui acheter des vêtements et des jouets. Shahd était un ange sur terre, elle était magnifique. Elle était la joie de la maison ».[162]
Afghanistan 2009 : Razia
Le 14 mars 2009, alors que la famille de Razia venait de finir le petit-déjeuner, deux obus au phosphore blanc se sont écrasés sur leur maison en terre crue.[163] Le feu et la fumée ont brûlé la maison et tué instantanément deux des sœurs de Razia qui dormaient côte à côte. L’attaque a blessé son père — Aziz —, sa mère et quelques-uns de ses autres frères et sœurs. Aziz a raconté : « Le bruit de l’explosion était très fort et j’ai pratiquement perdu conscience. Je ne pouvais pas réfléchir. Mes enfants me criaient : “Réveille-toi ! Tu es en train de brûler !” ». Enveloppée de flammes, Razia, 8 ans, a accouru vers Aziz.[164] Celui-ci l’a tenue serrée contre lui et lorsqu’il a enlevé sa main, le haut du cuir chevelu et une partie du visage de la fillette se sont décollés comme un masque.[165] Une porte-parole de l’armée américaine a déclaré que dans ce cas, l’origine de l’attaque était incertaine, celle-ci pouvant provenir aussi bien des troupes de l’OTAN que des talibans, et a reconnu que « les deux scénarios [étaient] possibles et tout aussi regrettables ».[166]
L’histoire de Razia met en lumière l’intense souffrance humaine qu’inflige le phosphore blanc, tant à court terme qu’à long terme, ainsi que les difficultés que pose le traitement des brûlures qu’il cause. Cette étude de cas s’appuie sur des comptes rendus de presse datant de la période d’hospitalisation de Razia, ainsi que sur des entretiens récents réalisés par les chercheur·euse·s de Human Rights Watch et de l’IHRC. Nous nous sommes en particulier entretenus avec deux reporters d’Associated Press (AP) qui ont couvert l’histoire de Razia, dont l’un est resté en contact avec la famille de cette dernière. Nous avons également interviewé l’infirmière référente qui s’est occupée de Razia pendant pratiquement toute la durée de son hospitalisation et est restée en contact périodique avec la famille. Razia et son père ont respectueusement décliné la demande d’interview formulée en vue du présent rapport.
Après l’attaque, Aziz a amené Razia dans une base locale de l’armée afghane qui n’a pas pu faire grand-chose pour les aider.[167] Un véhicule afghan privé les a conduits vers une base française proche. Pendant ce temps, Aziz versait de l’eau sur le visage de la fillette à chaque fois qu’il constatait qu’elle était en train de perdre conscience.[168] La base française n’était pas en mesure de fournir une assistance médicale appropriée et a fait venir un hélicoptère médicalisé qui l’a transportée vers l’hôpital américain, à la base aérienne de Bagram.[169] Lorsque le médecin — le sergent Stephen Park — est arrivé dans l’hélicoptère, apercevant les brûlures couvrant Razia « de la tête à la taille », il s’est demandé si elle était toujours en vie.[170] Il s’est souvenu : « C’était intense, chargé d’émotion. Lorsque nous sommes arrivés [à Bagram], je pense que même le personnel de la salle des urgences et l’ensemble des médecins et du personnel infirmier pensaient qu’elle ne s’en sortirait pas ».[171] Malgré des brûlures touchant 40 à 45 pour cent de son corps, en définitive, Razia a survécu grâce à des soins médicaux de grande envergure et très douloureux.
Ce que l’équipe médicale de l’armée américaine ignorait, c’est que Razia avait encore du phosphore blanc sur le visage et dans la gorge. Lorsqu’ils ont placé un masque à oxygène sur sa bouche, l’oxygène a rallumé le phosphore blanc et le masque a rapidement fondu. Alors que les médecins tentaient de retirer les tissus morts de ce qui restait de la peau de Razia, des flammes jaillissaient des blessures.[172]
Lorsque Christine Collins s’est portée volontaire pour endosser le rôle d’infirmière référente de Razia, trois ou quatre semaines après l’attaque, la fillette nécessitait encore des soins médicaux jour et nuit. Elle avait besoin de prendre régulièrement des antibiotiques pour éviter les infections et ne pouvait manger parce que les brûlures sur son visage entravaient les mouvements de sa bouche. L’un de ses yeux ne pouvant se fermer, pour dormir, elle devait faire rouler son globe oculaire vers le bas. L’amplitude de mouvement de son corps avait fortement diminué à cause des brûlures couvrant son visage, sa tête, son cou, son buste et ses bras.[173] Lorsque Christine Collins a lavé Razia pour la première fois, elle s’est retrouvée avec un morceau mort d’oreille en main.[174] Au cours des trois mois suivants, les médecins ont réalisé plus de 15 opérations chirurgicales, notamment des procédures de greffe de peau, à la fois pour maintenir Razia en vie et la remettre sur pied.[175]
Dans les jours qui ont suivi l’attaque, Razia a manifesté une grande souffrance émotionnelle. La fillette d’avant l’attaque dépeinte par Aziz à Christine Collins et au reporter d’AP, Rahim Faiez, était joyeuse et exubérante.[176] Christine Collins s’est souvenue que selon les dires d’Aziz, elle aimait jouer à l’extérieur avec ses frères et ne craignait pas de se salir.[177] Mais après l’attaque, Razia est devenue plus silencieuse et réservée.[178] Au départ, « Razia était extrêmement passive vis-à-vis de l’ensemble du personnel médical », a raconté Christine Collins à Human Rights Watch et à l’IHRC.[179] Elle était sous le choc de la perte de deux de ses sœurs et de sa maison, et les brûlures couvrant près de la moitié de son corps étaient atrocement douloureuses. Elle a également passé un mois dans un hôpital étranger où personne ne parlait sa langue et où seul son père pouvait lui rendre visite. Il restait allongé dans son lit, fixant le même mur « à longueur de journée ».[180]
Christine Collins et son équipe ont réussi à créer un lien avec Razia et à faire revenir des lueurs de bonheur dans sa vie, mais cela a nécessité une attention personnelle et des soins considérables auxquels la plupart des victimes d’armes incendiaires n’ont pas accès. Constatant que Razia, qui n’avait pas vu sa mère depuis l’attaque, avait besoin du réconfort qu’apporte le contact humain, Christine Collins et quelques autres employé·e·s de l’hôpital l’ont soulevée délicatement de son lit et l’ont transportée dans un fauteuil à bascule. « Je la berçais quelques heures et je lui chantais des chansons. Cela a très fortement modifié la façon dont elle a réagi au traitement par la suite. Ça a été une véritable expérience de vie ».[181] Même s’il « lui a fallu beaucoup de temps pour sortir de sa coquille » avec le personnel infirmier, au bout d’un certain temps, « elle n’hésitait pas à dire, OK, aujourd’hui, je ne ferai pas telle ou telle chose », a renchéri Christine Collins.[182] Les infirmières essayaient de lui remonter le moral en remplissant sa chambre de ballons et en lui appliquant du vernis rose sur les ongles. L’époux de Christine Collins lui a envoyé des cartons pleins de présents et de peintures de leurs trois filles.[183] Razia a même appris à dire « ice cream ».[184] Elle a lentement retrouvé la capacité de marcher, et même de courir.[185] Pourtant, Christine Collins s’est souvenue qu’elle « pleurait beaucoup à cause de la douleur. Tout cet épisode a pris le pas sur sa vie, mais elle est si jeune ».[186]
Malgré de nombreuses opérations chirurgicales, l’apparence physique de Razia sera modifiée à jamais à cause des brûlures. En mai ou en juin, Christine Collins a aperçu Razia se regardant dans un miroir depuis la première fois depuis l’attaque. « Elle n’a rien dit. Elle s’est regardée, a touché son visage, puis elle s’est simplement retournée et s’est éloignée ».[187] Sur des photos de Razia datant de 2016, les cicatrices et les dommages sur ses yeux sont encore visibles.
Le 24 juin, plus de trois mois après l’attaque, Razia a quitté l’hôpital de Bagram. Le personnel médical s’est réuni pour lui dire au revoir et « tout le monde pleurait ».[188] Elle est sortie de l’hôpital avec son père, une perruque donnée par la pédiatre sur la tête, en disant : « Je vais bien. Je veux rentrer à la maison ».[189] Christine Collins a commenté : « Ça a été un long parcours, tant pour elle que pour moi ».[190]
Le chapitre ouvert avec l’attaque au phosphore blanc n’était pourtant pas terminé. La maison de Razia a été totalement détruite dans l’incendie, et la famille a dû s’installer chez des proches, dans le même village. Ceux-ci ont cependant rapidement averti Aziz que sa famille n’était plus en sécurité. Lui et les siens ont donc fui à Kaboul. Ancien propriétaire de sa maison, gérant d’un magasin de légumes très fréquenté dans le village, Aziz louait à présent un logement dans la ville la plus coûteuse d’Afghanistan. Il devait trouver un nouvel emploi.[191] Razia n’est pas allée à l’école à Kaboul.[192] Aziz a confié à Rahim Faiez qu’il n’avait pas les moyens de payer des services de santé mentale ou des opérations de chirurgie esthétique pour sa fille.[193]
Les blessures physiques infligées par le phosphore blanc ayant des effets à long terme, Razia a dû subir une autre opération, plusieurs années après avoir quitté Bagram. Ses brûlures au cou avaient entraîné une fusion entre sa tête et son buste, désormais trop proches l’un de l’autre. Il lui était donc très difficile de tourner la tête et de parler. Vers 2014, Rahim Faiez a aidé à organiser un séjour de six mois de Razia en Allemagne. Là, elle a subi une opération qui a permis de séparer son cou de son buste, ce qui a amélioré la mobilité de sa tête et sa faculté de parler.[194]
Razia est également toujours aux prises avec les effets psychologiques et sociaux de ses blessures. « Je ne peux pas imaginer à quel point cela va être difficile pour Razia, parce que tout un côté de son visage est complètement brûlé et elle n’a pas de cheveux sur pratiquement tout le crâne », a commenté Rahim Faiez pour Human Rights Watch et l’IHRC.[195] L’ayant côtoyée à l’époque où elle est allée se faire opérer en Allemagne, il l’a décrite comme une enfant timide et introvertie. Plus récemment, a expliqué Rahim Faiez, « son père expliquait que lorsqu’ils sont invités à un mariage ou une fête familiale, sa première réaction est de refuser d’y aller. Ses parents l’y encouragent. Mais quand elle rentre, elle ne paraît pas heureuse d’y être allée. Aziz dit qu’il lui parle pendant des heures ».[196]
Razia et son histoire ont également fortement impressionné les personnes qui la connaissaient. Jason Straziuso, qui l’a rencontrée en tant que reporter chez AP, a récemment confié : « Je pense que son histoire résonne en moi parce qu’elle résonnerait en n’importe qui. Nous sommes tous capables d’imaginer la souffrance d’une enfant et de penser que cela n’aurait pas dû se passer ainsi ».[197] Interrogée sur le phosphore blanc responsable des souffrances de Razia, Christine Collins a déclaré, à titre personnel : « Il faut contrôler d’une façon ou d’une autre ce type d’arme. Absolument, à 100 pour cent ».[198]
Syrie 2013 : Urum al-Kubra
Le 26 août 2013, à Urum al-Kubra, une ville au nord du gouvernorat d’Alep, les forces du gouvernement syrien ont attaqué un bâtiment de trois étages situé à environ 100 mètres de l’Institut Iqraa, une école qui accueille des élèves de niveau intermédiaire et secondaire.[199] Muhammed Assi, alors âgé de 18 ans, et d’autres élèves, sont vite sortis pour voir ce qu’il s’était passé. « Nous avons vu un avion dans le ciel. Il était très éloigné, alors nous avons pensé qu’il ne nous toucherait pas », a-t-il rapporté à Human Rights Watch et à l’IHRC.[200] Les enseignants ont pressé les jeunes de rentrer se mettre à l’abri.[201] Mais Muhammed et cinq autres élèves sont restés dans la cour, qui comportait un terrain de jeux, à parler de l’attaque et de ce qu’ils étudieraient l’année suivante. Soudain, le groupe a entendu un son faible « jamais entendu avant », et « il y a eu de grosses flammes et des émanations étouffantes ».[202] Une bombe incendiaire avait atterri au milieu des six élèves, dont cinq ont immédiatement péri. « L’intensité de l’explosion m’a projeté à environ 3 à 4 mètres du point de chute du missile », s’est souvenu Muhammed. « Nous étions entourés de feu. J’ai utilisé mes mains pour recouvrir ma tête et j’ai essayé d’éteindre le feu ».[203]
Cette attaque et l’histoire de Muhammed mettent en lumière les terribles dommages causés par l’utilisation d’armes incendiaires dans des lieux abritant des concentrations de civils, ainsi que leurs effets physiques, psychologiques et sociaux à long terme. Les expériences des médecins de l’hôpital local d’al-Atarib soulignent également les difficultés que présente le traitement des victimes d’armes incendiaires dans un environnement de conflit armé. Cette étude de cas s’appuie sur des entretiens récents de Human Rights Watch et de l’IHRC avec Muhammed Assi ; un enseignant témoin de l’attaque, qui a préféré rester anonyme ; et deux médecins, Saleyha Ahsan et Rola Hallam, qui ont soigné les étudiants blessés ce jour-là dans le cadre d’un volontariat auprès de l’organisation humanitaire britannique Hand in Hand For Syria. Human Rights Watch a également interrogé Mustafa Haid, un activiste arrivé sur les lieux, à l’hôpital al-Atarib, peu de temps après l’attaque.
L’enseignant s’est souvenu de l’horreur de la scène. « J’ai entendu de nombreux jeunes crier. Il y avait des cris partout », a-t-il raconté.[204] Lorsque les enseignant·e·s et les élèves sont sortis de l’école, ils « ont vu les corps sans vie des étudiants, c’était épouvantable. D’autres élèves avaient des brûlures, mais ils étaient encore conscients, ils parlaient ». L’enseignant a vu trois étudiants brûlés qu’il ne pouvait plus reconnaître.[205]
Encerclé par les flammes, Muhammed est resté immobile un certain temps. « Le temps semble s’arrêter lorsque ces choses vous arrivent... », a-t-il commenté. « Les mots ne peuvent décrire ce que j’ai ressenti, mais j’ai vu le feu qui m’entourait complètement, de partout, et lorsque le vent s’est mis à souffler, il a apporté de l’oxygène à la substance incendiaire et a ravivé le feu ».[206] Au bout d’un certain temps, un enseignant lui a dit qu’ils devaient partir. Muhammed s’est souvenu avoir vu, lorsqu’il a commencé à marcher, « de nombreux élèves sur le sol, gravement brûlés, qui appelaient à l’aide, mais personne ne venait les secourir. Certains essayaient de casser les fenêtres et les vitres à mains nues pour sortir indemnes ».[207] Des civils locaux les ont rapidement emmenés en camionnette à l’hôpital d’al-Atarib, à 20-25 minutes de là, car il n’y a pas d’hôpital à Urum al-Kubra.[208]
Peu de temps après l’attaque, l’hôpital débordait d’élèves blessé·e·s.[209] « Honnêtement, cela ressemblait à une scène d’Armageddon », a décrit la Dre Hallam. « À leur arrivée, ils étaient tous dans un état très semblable. Leurs vêtements étaient en lambeaux. Ils dégageaient une horrible odeur de chair roussie, à laquelle s’ajoutait une bizarre odeur chimique artificielle (...) Il était très clair qu’ils avaient des brûlures graves, et l’une des [choses] les plus alarmantes, chez [certain·e·s], était la faible douleur ressentie, ce qui est immédiatement un signal d’alerte indicateur de l’étendue des brûlures, car nous savons que les brûlures graves ne sont pas douloureuses ».[210]
Dans un premier temps, le personnel médical n’a pas identifié la source des brûlures graves de ces patient·e·s et de la poudre blanche qui les couvrait.[211] Après l’attaque à l’arme chimique à Ghouta, environ une semaine auparavant, les médecins de l’hôpital d’al-Atarib craignaient que les blessures qu’ils étaient en train de soigner n’aient été provoquées par des armes de ce type.[212] « Nous les avons lavés au jet d’eau à leur arrivée pour stopper les brûlures et enlever toute autre substance pouvant se trouver sur leur corps », a expliqué la Dre Hallam.[213] On leur a appris par la suite que la poudre blanche couvrant les victimes était en réalité de la poussière issue de l’impact d’une arme incendiaire.[214] Muhammed s’est souvenu : « Lorsque nous sommes arrivés à l’hôpital, les médecins n’avaient pas beaucoup d’expérience dans le traitement de ce genre de substance, alors ils ont commencé par nous asperger d’eau et de sérums, et cela a d’abord eu un effet apaisant, mais moins d’une minute plus tard, la douleur s’est amplifiée ».[215]
Mustafa Haid, qui était venu à l’hôpital pour faire état de l’attaque avec ses frères, a qualifié la scène d’« horrifiante ». « Imaginez : Vous avez devant vous des enfants en train de brûler et suivant votre instinct, vous leur jetez de l’eau, mais cela ne fait qu’intensifier leur douleur. C’était horrible. Je pouvais encore voir la peau peler, même s’il n’y avait pas de feu en soi », a-t-il raconté à Human Rights Watch.[216]
Muhammed avait des brûlures sur plus de 85 pour cent de la surface de son corps.[217] Il a expliqué qu’elles couvraient la moitié de son visage, une oreille, son cou, ses épaules, son dos, sa main, ses deux jambes et ses pieds. Il avait également du mal à respirer et avait des brûlures à l’estomac.[218] Malgré la douleur, il a adressé un signal de paix à l’équipe de tournage de la BBC qui réalisait un documentaire sur la Dre Hallam et la Dre Ahsan.[219] « Le signal de paix, c’était simplement pour dire que malgré tout ça, nous voulons vivre et rester en vie, et nous ne nous arrêterons pas, quoi qu’il arrive », a-t-il précisé.[220]
D’autres étudiant·e·s ont également subi des blessures graves. La Dre Hallam a décrit un garçon qui semblait être « en bois » à son arrivée à l’hôpital.[221] « Il était de toute évidence brûlé. [Sa voix rauque] m’a immédiatement indiqué qu’il était brûlé à l’intérieur, que les brûlures avaient atteint sa gorge... Je savais qu’il mourrait dans l’heure », a-t-elle ajouté. « Comme nous devions traiter des urgences de masse, j’aurais dû simplement le laisser mourir, car [le soigner] était futile, d’un point de vue médical, mais je savais qu’il mourrait d’étouffement. J’ai fini par l’intuber et pratiquer la ventilation et je l’ai endormi (...) et il est parti ainsi ».[222]
Les médecins se sont souvenues, en particulier, des souffrances d’une étudiante de 18 ans qui s’appelait Siham Qanbari.[223] « Elle aurait dû être la plus brillante et la meilleure élève de sa classe, et même si [aller à l’école] était risqué, à cause de tous ces bombardements, elle insistait pour poursuivre ses études », a raconté la Dre Hallam, qui a soigné Siham.[224] À son arrivée à l’hôpital d’al-Atarib, Siham souffrait à l’extrême à cause de blessures sur plus de 60 pour cent de son corps.[225] La Dre Hallam a confié à Human Rights Watch et l’IHRC : « Je savais que son cas ne se présentait pas bien. Elle avait des brûlures majeures, son visage était brûlé, ses vêtements étaient en lambeaux, une horrible odeur de chair brûlée se dégageait, pas seulement d’elle, mais aussi des dizaines d’enfants qui arrivaient ». Le père de Siham, Ridwan, « n’arrêtait pas de me supplier — “S’il vous plaît, soignez-la comme si c’était votre propre fille”. Je n’avais pas de fille à l’époque, mais maintenant oui », a-t-elle commenté.[226] Siham a été transférée dans un hôpital en Turquie mais a succombé plus tard à ses blessures.[227]
L’insuffisance des soins de santé disponibles a exacerbé les difficultés que présentait le traitement des blessures de ces étudiant·e·s. L’hôpital d’al-Atarib avait déjà été endommagé auparavant suite à des combats répétés dans cette région. Mustafa Haid, photographe venu sur les lieux pour documenter l’attaque, a dit que ses frères s’étaient portés volontaires pour enfiler des gants médicaux et étaler de la crème sur les brûlures des enfants.[228]
À cause de ces contraintes en ressources et de la gravité des brûlures provoquées par les armes incendiaires, pour un grand nombre de ces enfants, l’hôpital n’a pas pu faire grand-chose. Plusieurs sont décédés immédiatement ; leurs corps étaient « carbonisés » au-delà de toute possibilité de les reconnaître.[229] Mustafa Haid a décrit deux corps tellement brûlés que leurs traits n’étaient pas reconnaissables.[230] « Nous n’avons même pas dû confirmer leur décès, comme le veut l’usage », a déploré la Dre Hallam. « J’aurais dû pouvoir administrer de l’oxygène, des calmants, des antidouleurs [aux enfants blessés] (...) La plupart auraient dû être intubés et il aurait fallu pratiquer la ventilation, car tous et toutes avaient de très importantes brûlures, et je pouvais voir qu’ils salivaient déjà », signe de brûlures internes majeures.[231] La Dre Ahsan, tout aussi frustrée des soins limités qu’elle était en mesure de fournir, a affirmé à Human Rights Watch et à l’IHRC qu’elle « était en colère avec le monde, en colère avec le fait que nous ne faisons rien et que cela continue, toute en sachant parfaitement qu’il ne s’agit pas d’un [incident] isolé ».[232]
Mal équipées pour soigner les effets des armes incendiaires, les médecins ont transféré Muhammed et d’autres élèves gravement brûlés vers des hôpitaux turcs au bout de quelques heures.[233] Muhammed se souvient de son trajet de 30 à 45 minutes en ambulance vers la Turquie, et de son attente pour passer la frontière, qui a duré une ou deux heures. Une ambulance a fini par arriver pour l’amener, avec d’autres élèves, vers les postes frontaliers de premiers secours, puis vers des hôpitaux turcs. Il a été transporté vers l’Hôpital Defne à Antakya. [234]
Muhammed, tout comme les autres élèves transférés, avait besoin de soins médicaux poussés. Il a raconté à Human Rights Watch et à l’IHRC que l’équipe médicale l’avait rapidement emmené en salle d’opération et l’avait ensuite transféré dans l’unité de soins intensifs.[235] Au début, sa famille ne pouvait pas le reconnaître. Des liquides lui étaient administrés par la voie de tuyaux parce que les brûlures avaient endommagé ses mâchoires et ses intestins. Son premier séjour à l’Hôpital Defne a duré environ 100 jours. Entre sa première sortie d’hôpital et fin 2015, il est retourné cinq fois en Turquie, depuis la Syrie, à chaque fois pour une durée d’environ deux mois.[236]
Muhammed, aujourd’hui âgé de 25 ans, subit encore les conséquences physiques, psychologiques et sociales de cette attaque. Il ne souffre plus de douleurs chroniques, mais 85 pour cent de son corps est recouvert de cicatrices et il a perdu l’usage de sa main gauche.[237] Il a confié qu’après l’attaque, pendant six mois, il a vécu à nouveau cette scène chaque nuit dans ses cauchemars. Pendant la journée, il restait chez lui. Il s’est souvenu : « Dès que je sortais de chez moi, je rentrais au bout de cinq à dix minutes, parce que je ne voulais pas être interpellé dans la rue pour qu’on me demande “Qu’est-ce qu’il est arrivé à ton corps ? Que sont ces brûlures ?” ». Il a ajouté : « Le plus dur, c’est que mon jeune neveu a peur de s’approcher de moi, et un autre neveu, qui venait souvent me faire des câlins, a peur de jouer avec moi ».[238] Depuis lors, il a suivi une psychothérapie auprès d’un médecin syrien installé en France et s’est habitué aux questions des inconnu·e·s, mais, a-t-il précisé, certaines personnes sont effrayées à la vue de ses cicatrices.[239]
Les effets à long terme de ces blessures ont freiné la trajectoire de Muhammed, dont l’objectif était d’étudier la cybersécurité. À cause de ses problèmes répétés de santé, il n’a pas repris ses études, et même s’il n’a pas abandonné ses objectifs professionnels à long terme, il souhaite faire quelque chose d’utile dans l’immédiat.[240] Il a accepté un emploi humanitaire auprès d’une ONG syrienne qui fournit des chauffages, avant l’hiver, aux réfugié·e·s vivant dans des camps, et est également chargé de la protection du matériel dans un centre d’isolement Covid-19.[241]
L’enseignant, quant à lui, n’a pas été blessé physiquement, mais la scène de l’attaque dont il a été témoin l’a traumatisé durablement. « Ma vie tout entière en est affectée », a-t-il déclaré, ajoutant que la première année, « [il avait] fait des cauchemars toutes les nuits ». Il souffre également d’insomnie et d’irritabilité. « C’était très dur, c’est impossible à décrire avec des mots ».[242] Les cauchemars sont moins intenses à présent, mais il a toujours peur des bruits retentissants. « Mon cerveau souffre à chaque fois que je reviens à cet épisode », a-t-il résumé.[243]
Les collaborateurs et collaboratrices de Human Rights Watch et de l’IHRC interviewé·e·s à propos de cette attaque ont souligné la nécessité de mettre en lumière la souffrance humaine que causent les armes incendiaires et de faire en sorte que ce genre de situation ne se reproduise pas. Selon la Dre Hallam, « il faut dire aux gens quels sont les coûts humains. Rien ne changera à moins que l’on ne concentre l’attention sur la souffrance immense que génèrent ces attaques. Je ne suis que simple témoin, mais ce que j’ai vu continue de surgir dans mon esprit sept ans plus tard ».[244] La Dre Ahsan, qui revit elle aussi ces scènes par intermittence, nous a fait part de ses réflexions : « C’est vraiment avec la Syrie que j’ai commencé à me dire “Sommes-nous à nouveau à ce point de l’Histoire (...) où nous sommes confrontés à notre manque d’humanité, où nous sommes en train de perdre notre humanité ? (...)”. Je pense qu’il est de l’intérêt de tous et de toutes de nous rassembler et de réfléchir à ce que nous allons faire à ce sujet ».[245]
Les survivant·e·s et les témoins ont exhorté les Nations Unies à réagir. « Les êtres humains ont le droit de vivre dignement », a déclaré Muhammed, qui demande que cessent d’être utilisées « des armes dont l’utilisation contre les civils, les écoles et les hôpitaux est interdite par des conventions ».[246] L’enseignant a commenté : « Je respecte les Nations Unies sans réserve, mais quelle est sa mission ? Elle devrait être de protéger les gens (...) C’est une formidable organisation, mais nous avons besoin d’actions, d’actions pour [aider] non seulement le peuple syrien, mais également les autres personnes dans le monde qui souffrent réellement de la guerre ».[247]
Empêcher les souffrances humaines considérables causées par des armes incendiaires nécessite des lois internationales solides auxquelles les États adhèrent et qu’ils respectent. Le Protocole III de la CCAC a pour objectif de protéger les civils et les biens de caractère civil en réglementant l’utilisation d’armes incendiaires « à l’intérieur d’une concentration de civils » et dans les « forêts et autres types de couverture végétale ».[248] Néanmoins, il comporte deux lacunes légales qui réduisent son efficacité.
Premièrement, on peut dire que la définition que donne le Protocole III des « armes incendiaires » exclut la plupart des munitions incendiaires polyvalentes. Selon l’Article 1(1), une arme incendiaire est « toute arme ou munition essentiellement conçue pour mettre le feu à des objets ou pour infliger des brûlures à des personnes par l’action des flammes, de la chaleur ou d’une combinaison des flammes et de la chaleur, que dégage une réaction chimique d’une substance lancée sur la cible ». Cette définition n’englobe pas les munitions telles que celles contenant du phosphore blanc, qui mettent le feu et provoquent des brûlures, mais sont « essentiellement conçues » pour créer des écrans de fumée ou à des fins de signalisation des troupes.[249] La nature ou la magnitude de l’impact ou des blessures ne sont pas prises en compte tant que l’on considère que la fonction essentielle est exclue du champ d’application du protocole. L’applicabilité du Protocole III dépend donc fortement de la façon dont les concepteurs, les fabricants et les utilisateurs décrivent la finalité d’une arme.
Deuxièmement, le Protocole III émet une distinction arbitraire et dépassée entre armes incendiaires lancées depuis le sol ou larguées par aéronef. Il interdit l’utilisation de modèles air-sol à l’intérieur de concentrations de civils, mais la disposition relative à l’utilisation d’armes incendiaires lancées depuis le sol dans ces zones comporte certaines réserves qui les excluent de l’interdiction. Cette lacune écarte le fait, bien réel, que les armes incendiaires provoquent des brûlures aussi épouvantables et destructrices que le feu, quel que soit le mécanisme de lancement. Par ailleurs, les armes incendiaires lancées depuis le sol, en particulier au moyen de lance-roquettes multiples, peuvent avoir des effets sur de vastes zones, qui sont comparables à ceux des armes larguées depuis les airs. C’est pourquoi elles sont dangereuses pour les civils lorsqu’elles sont utilisées dans des zones peuplées. Enfin, les groupes armés non étatiques, qui ont davantage accès aux armes incendiaires lancées depuis le sol, pourraient avoir l’impression que l’interdiction d’utilisation est moins contraignante si le droit international, et les lois qui en découlent, ne sont pas parfaitement irréfutables.
Du point de vue juridique, sinon politique, il est aisé de combler ces deux lacunes. L’Article 1(1) du Protocole III pourrait être modifié de façon à redéfinir les armes incendiaires comme des armes qui « ont pour effet de mettre le feu et d’infliger des brûlures (...) ». L’Article 2 pourrait être réécrit de façon à interdire l’utilisation de toute arme incendiaire, quel que soit le mécanisme de lancement, à l’intérieur d’une concentration de civils. Ces changements permettraient de renforcer les règles présentées aux États parties et de condamner plus fermement l’usage d’armes incendiaires, afin d’influencer également les personnes agissant hors du cadre du traité.
Depuis 2010, l’emploi d’armes incendiaires en Afghanistan, à Gaza, en Irak, en Syrie, en Ukraine, au Yémen et dans d’autres régions suscite des débats à chaque réunion annuelle de la CCAC. Au cours de la dernière décennie, au moins 36 États, l’Union européenne et d’autres acteurs internationaux ont exprimé publiquement leur préoccupation quant à l’utilisation d’armes incendiaires et du phosphore blanc.[250] En 2017, le soutien croissant apporté à la révision du Protocole III a conduit à l’inscrire à l’ordre du jour de la réunion des États parties de la CCAC. Cependant, en raison de pressions exercées par quelques États, et plus notablement de la Russie, ce sujet a disparu des ordres du jour de 2019 etde 2020.
En dépit de l’absence de ce point à l’ordre du jour de leur dernière réunion en date, qui s’est tenue en novembre 2019, les États parties à la CCAC ont trouvé des moyens d’aborder ce sujet. Les personnes qui souhaitaient s’exprimer ont pu le faire au moment de l’« Échange de vues général » ou sous le point 12 de l’ordre du jour — « État de l’application et du respect des dispositions de la Convention et des Protocoles y annexés ». La quasi-totalité des 17 États participant aux débats relatifs aux armes incendiaires a exprimé des préoccupations quant à l’emploi de ces dernières, ainsi que le souhait d’engager des discussions dédiées à ce sujet. La Russie et les États-Unis ont en définitive bloqué les propositions visant à réserver un temps de discussion dédié au Protocole III de la CCAC en 2020. Grâce à la ténacité de certains États, cependant, le rapport final reflétait cette préoccupation largement partagée et, contrairement à l’année précédente, reconnaissait les appels à inscrire à nouveau le protocole à l’ordre du jour des prochaines réunions.[251]
Condamnation et préoccupations
En 2019, au moins 13 États, ainsi que l’Union européenne, ont jugé préoccupant l’emploi d’armes incendiaires sur des civils depuis le début du conflit syrien et l’ont condamné.[252] De nouvelles voix s’étaient jointes aux débats : sur ces 13 États, cinq ne s’étaient pas exprimés à ce sujet lors de la réunion de la CCAC de 2018. Dans leurs interventions, les États ont mis l’accent sur la souffrance humaine causée par ces armes. L’Autriche a par exemple rappelé qu’elle restait « profondément préoccupée par l’impact humanitaire causé par l’utilisation d’armes incendiaires, en particulier les souffrances inacceptables qu’elles infligent ».[253] La Nouvelle-Zélande a souligné les « conséquences épouvantables de l’utilisation d’armes incendiaires sur les civils ».[254] De même, l’Union européenne a déclaré qu’elle « restait fortement préoccupée par la situation en Syrie, qui inflige des souffrances inacceptables aux populations civiles ».[255] L’Allemagne, l’Australie, la Belgique, le Chili, le Costa Rica, l’Irlande, la Jordanie, le Mexique, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse ont ajouté leur voix à la désapprobation exprimée par ces délégations.
Le rapport final de la réunion reflétait ces points de vue. Il y était déclaré que « plusieurs délégations [avaient] exprimé des inquiétudes au sujet des récentes allégations, de plus en plus nombreuses, relatives à l’utilisation d’armes incendiaires contre des civils, et ont condamné toute utilisation de telles armes contre des civils ou des biens de caractère civil et toute autre utilisation incompatible avec les règles pertinentes du droit international humanitaire, notamment, s’il y a lieu, les dispositions du Protocole III ».[256]
Appel à poursuivre les débats et à inscrire le sujet à l’ordre du jour
La plupart des États qui se sont exprimés lors de la réunion annuelle 2019 de la CCAC ont apporté leur soutien à la demande de poursuivre les débats sur les armes incendiaires. Six d’entre eux ont spécifiquement demandé que le Protocole III soit inscrit à l’ordre du jour de la réunion annuelle de 2020.[257] Par exemple, l’Union européenne, qui représente 28 États membres, et trois autres États, ont déclaré : « Nous regrettons que les questions liées au Protocole III aient été retirées de l’ordre du jour de la CCAC parce que l’une des Hautes Parties contractantes s’opposait à ce qu’il y figure, et nous demandons qu’elles y soient à nouveau inscrites en 2020 ».[258] Le Mexique, préoccupé par les allégations d’utilisation d’armes incendiaires, a estimé que la poursuite du débat était particulièrement nécessaire, étant donné « les implications humanitaires de l’utilisation de ces armes, qui contrevient aux obligations des parties, et les lacunes que présente » la loi.[259]
Reconnaissant la nécessité de discuter plus longuement du Protocole III, la Nouvelle-Zélande a appelé à remettre ce point à l’ordre du jour pour la réunion annuelle 2020 de la CCAC. Elle s’est également « [prononcée] en faveur d’une réunion informelle où il serait question de l’universalisation, de la mise en œuvre et de l’adéquation du protocole III à la lumière des préoccupations humanitaires qui entourent les armes incendiaires ».[260] Cette réunion se tiendrait hors de la Réunion formelle des États parties et permettrait d’étoffer davantage les débats.
Pour l’avenir, la Suisse a avancé que le Protocole III devrait être abordé lors de la Conférence chargée de l’examen de 2021, soulignant que cette Conférence offrait une occasion précieuse d’étudier cette question en profondeur.[261]
Les organisations internationales et non gouvernementales ont également accueilli favorablement ces débats et appelé leur poursuite de leurs vœux. Le Comité international de la Croix-Rouge a exhorté tous les États à adhérer sans délai au protocole et à communiquer leurs politiques et pratiques opérationnelles concernant l’utilisation d’armes incendiaires afin de mieux étayer la pertinence du Protocole III et du droit international coutumier.[262] Des organisations de la société civile, dont Human Rights Watch, PAX et Mines Action Canada, ont appelé à la fois à poursuivre les débats et à modifier le Protocole III afin de le renforcer.
Enfin, le rapport final propose une synthèse des appels des États parties à poursuivre les débats. Il énonce que « certaines délégations ont réclamé le rétablissement d’un point de l’ordre du jour consacré au Protocole III, alors que d’autres délégations ont estimé que cela n’était pas nécessaire ».[263]
Renforcer ou modifier le Protocole III
Une dizaine d’États, au moins, ont appelé à modifier le Protocole III de façon à en combler les lacunes résultant de distinctions arbitraires et désormais datées.[264] En 2019, au moins quatre États ont réitéré cet appel.[265] L’Autriche, par exemple, a plaidé pour « renforcer le Protocole III afin de prévenir les dommages insidieux causés par ces armes ».[266] Le Chili a souligné que le Protocole III, sous sa forme actuelle, est limité, car il exclut l’utilisation d’armes polyvalentes et crée des distinctions entre armes lancées depuis le sol ou depuis les airs.[267]
Les souffrances humaines durables provoquées par les armes incendiaires mettent en lumière la nécessité de renforcer le droit international. Les déclarations prononcées lors de la réunion de 2019 de la CCAC démontrent qu’il existe une volonté d’examiner plus avant la pertinence du Protocole III. Les États parties devraient donc convenir d’accorder du temps, en 2021, à des débats sur les insuffisances du Protocole III, et d’inscrire les armes incendiaires à l’ordre du jour de la Conférence chargée de l’examen de 2021. La Conférence elle-même devrait se donner pour mission de réviser et de modifier le Protocole III. Ces mesures permettront de saisir pleinement cette occasion que présente la Conférence de passer de la parole aux actes et de renforcer la protection des civils contre l’horreur des armes incendiaires.
L’autrice principale de ce rapport est Bonnie Docherty, chercheuse senior auprès de la division Armes de Human Rights Watch et directrice associée de la section Conflits armés et protection civile à l’International Human Rights Clinic (IHRC) de la faculté de droit de Harvard. Erin Shortell, Jamie Magcale, Aanchal Chugh et Shaiba Rather, étudiantes à l’IHRC ont largement contribué à cette étude, aux analyses et à la rédaction de ce rapport.
Ce rapport a été révisé et édité par Steve Goose, directeur exécutif de la division Armes de Human Rights Watch, et Mary Wareham, directrice du plaidoyer auprès de cette division. Le rapport a également été relu par Jane Buchanan, directrice adjointe de la division Droits des personnes handicapées ; Patricia Gossman, directrice adjointe de la division Asie ; Sara Kayyali, chercheuse sur la Syrie ; Omar Shakir, directeur de recherche sur Israël et la Palestine ; et Bill Van Esveld, directeur adjoint de la division Droits des enfants. James Ross, directeur des affaires juridiques et politiques, et Tom Porteous, directeur adjoint de la division Programmes, en ont révisé les aspects juridiques et programmatiques. La traduction en français a été réalisée par Cathia Zeoli, et relue par Peter Huvos. Ce rapport a été préparé en vue de sa publication par Jacqulyn Kantack, collaboratrice auprès de la division Armes, Fitzroy Hepkins, responsable administratif senior, et José Martinez, gestionnaire administratif.








