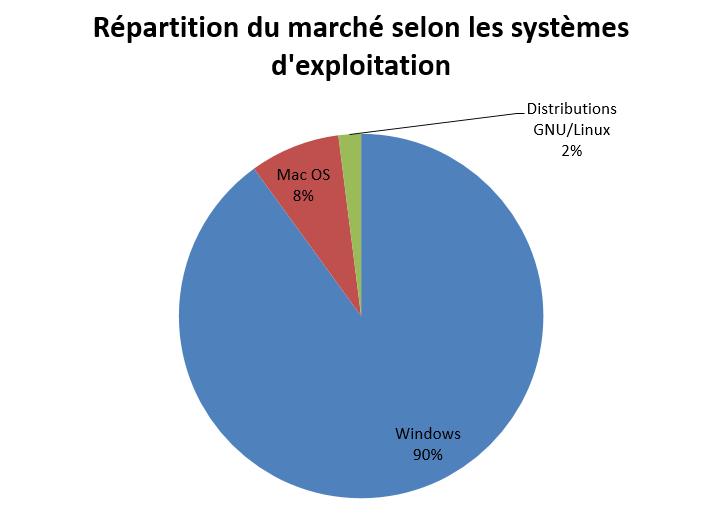Jonathan Franzen: «Si ce pays tombait dans le fascisme, alors je me prendrais sûrement une balle»
Temps de lecture: 29 min
Dans cet entretien avec Jonathan Franzen, le journaliste Isaac Chotiner note que: «Chacune des incursions de l'écrivain dans la vie publique, qu’il donne une interview ou qu’il écrive des essais, donne quasiment toujours lieu à des controverses». Celui-ci ne fait pas exception.
Publié le 31 août, ce grand entretien a suscité une polémique, notamment à cause d'un passage:
Cela aura même abouti à des tweet clashs entre romanciers fort respectables:
Nous traduisons ici l'entretien dans son intégralité.
***
«À Manhattan il n’y a plus que des agences bancaires» déplore Jonathan Franzen en traversant le salon de sa maison de Santa Cruz, en Californie. Lorsqu’il retourne dans son ancien quartier de l’Upper East Side, il ne peut que se dire: «Là il y avait une jolie épicerie; maintenant c’est une banque. Ça c’était un chouette magasin d’alcools, maintenant c’est une banque.» Santa Cruz, ville universitaire et balnéaire, lui convient mieux. La maison de Franzen, bien qu’intégrée à un complexe immobilier générique, est perchée au-dessus d’un magnifique ravin avec une très jolie vue à la fois sur l’océan et sur le parc naturel en contrebas. Les occasions d’observer les oiseaux, occupation chère au cœur de Franzen, abondent (lorsque la conversation a bifurqué vers la Jamaïque, il a évoqué avec désinvolture qu’il avait eu l’occasion de voir 27 des 29 espèces d’oiseaux endémiques de l’île). Il partage le lieu avec sa partenaire de longue date, Kathy Chetkovich, également écrivain.
J’ai d’abord aperçu Franzen, en tenue décontractée, en train de relever son courrier devant la maison. À l’intérieur, le salon, modeste, est bien rangé et moins chargé de livres qu’on ne pourrait s’y attendre. Franzen a aujourd’hui 56 ans, mais malgré ses cheveux grisonnants et sa barbe de quelques jours, son visage est resté juvénile. Pour quelqu’un si souvent qualifié de distant, voire grincheux, il est étonnamment amical et ouvert. Lorsque je lui confesse que je ne suis pas amateur d’oiseaux, il m’en recommande l’observation avec une générosité passionnée et me propose des endroits particuliers dans ma ville d’Oakland, en Californie, avec la sincérité de quelqu’un qui n’essaie pas de vous dire quoi faire mais qui suggère quelque chose dont il est authentiquement convaincu que cela vous donnera du plaisir.
Franzen a publié son premier roman, La 27e ville, en 1988. Mais ce n’est qu’à son troisième livre, Les corrections (2001), qu’il est devenu à la fois un objet d’adulation et de polémique à grande échelle. Depuis qu’il s’est querellé avec Oprah Winfrey—l’équivalent médiatique d’une invasion de la Russie—après que Les corrections avait été choisi par le club littéraire de la présentatrice, il évite largement la publicité. À cheval entre intello et classe moyenne, c’est un romancier commercial au succès monumental capable de paraître mal à l’aise devant le succès commercial de son œuvre. Chacune de ses incursions dans la vie publique, qu’il donne une interview ou qu’il écrive des essais, donne quasiment toujours lieu à des controverses.
Ces dernières années par exemple, il a été beaucoup raillé pour avoir envisagé d'adopter un orphelin irakien, et critiqué pour avoir écrit un article sur le réchauffement climatique pour le New Yorker dans lequel il prétend que devant l’échelle du problème, les humains envoient promener des sujets urgents comme la protection des oiseaux. Ses détracteurs l’ont parfois joyeusement fossilisé dans le rôle de «romancier blanc qui n’y connaît rien», d’intello déconnecté des réalités qui, selon eux, squatte bien plus les projecteurs culturels qu’il ne le mérite.
Freedom, publié en 2010, et Purity, sorti l’année dernière, sont à la fois des romans de plus de 500 pages qui ont suscité des louanges considérables puis des débats furieux pour savoir si leur réception élogieuse était exagérée—et un symptôme des préjugés sexistes dans la critique littéraire.
Les droits de Purity, sorti en poche en VO depuis la semaine dernière, ont déjà été rachetés par la télévision—dans son adaptation par la chaîne Showtime, Daniel Craig jouera Andreas, le personnage de style Julian Assange qui domine la plus grande partie d’une histoire dont l’intrigue se déroule dans le monde entier (et en partie à Santa Cruz).
A LIRE AUSSI
Franzen, le Tolstoï de l'ère internet
Lire l'article
Avant de commencer l’interview, Franzen me propose un expresso et suggère que nous nous installions à table pour qu’il ne soit pas tenté de s’endormir. Nous parlerons pendant plus d’une heure. Souvent, un très long silence précède ses réponses à mes questions; il articule clairement et visiblement se soucie de trouver le mot juste—davantage dans l’optique de s’exprimer correctement que pour sacrifier au politiquement correct. Mais il s’emporte parfois et s’exprime alors avec une rapidité théâtrale.
Au cours de notre conversation, éditée et condensée pour plus de clarté, nous avons parlé de l’impact de la célébrité sur un auteur, de l’idée qu’il écrive un roman sur les questions raciales et de la santé mentale de Donald Trump.
Isaac Chotiner: L’Amérique vient de vivre une année très bizarre. Est-ce que votre manière de penser le pays a fondamentalement changé?
Jonathan Franzen: Eh bien, en ce moment il se passe deux grandes choses distinctes. L’une est l’état des relations interraciales, et l’autre, tout à fait indépendante—bien qu’il y ait des points de convergence entre les deux—est l’émergence de Trump et de Sanders en tant que candidats protestataires ayant décroché la nomination de leur parti ou ayant été à deux doigts de le faire. La question raciale est très présente dans les informations en ce moment à cause de ces tirs de la police.
Ce phénomène semble tout à fait distinct. J’ai lu quelque part, je crois que c’était dans le New Yorker, que le radicalisme a tendance à émerger non pas quand les temps sont les plus durs mais quand on a donné de l’espoir au gens et qu’il a été déçu.
Avez-vous déjà envisagé d’écrire un livre sur la question raciale?
Ça me gêne de l’avouer–je n’ai pas beaucoup d’amis noirs. Je n’ai jamais été amoureux d’une femme noire. Je pense que si ça m’était arrivé, alors j’aurais pu oser écrire un livre sur la question raciale
J’y ai pensé mais—ça me gêne de l’avouer—je n’ai pas beaucoup d’amis noirs. Je n’ai jamais été amoureux d’une femme noire. Je pense que si ça m’était arrivé, alors j’aurais pu oser le faire.
[Je règle le micro, qu’il fixe pendant un moment.] Bien, bien, bien. Le micro. Vous avez pointé le micro sur moi. Y’a que moi qui parle, là. [Il se tait.]
Vous disiez que vous n’étiez jamais tombé amoureux d’une femme noire.
C’est vrai. Je ne suis pas entré dans une famille noire par le mariage. J’écris sur des personnages, et il faut que j’aime un personnage pour écrire sur lui. Si vous n’avez pas vécu l’expérience directe d’avoir aimé une catégorie de personne—quelqu’un d’une autre couleur que vous, ou de profondément religieux, des choses qui sont de vraies différences—il me semble qu’il est très difficile d’oser écrire du point de vue de cette personne, ou même d’en avoir envie.
Pour Purity, j’avais toute cette matière sur l’Allemagne. J’y avais passé deux ans et demi. J’en connaissais assez bien la littérature, pourtant je n’aurais jamais pu écrire dessus parce que je n’avais aucun ami allemand. Ce qui m’a permis d’être capable d’écrire dessus, ça a été de soudain rencontrer ces amis que j’aimais vraiment. Alors je n’étais plus l’étranger hostile; j’étais l’initié aimant.
Pourtant dans vos romans il y a de toute évidence des personnages qu’on ne peut pas aimer.
Ah, mais comment définiriez-vous l’amour?
En fait j’étais justement en train de me demander ce que vous, vous entendiez par le mot amour.
Hmmmmmm.
Au début de Purity, on entre dans la tête de Pip, au moment où elle fait la liste de ce que signifie pour elle d’aimer sa mère: elle a pitié d’elle, partage sa souffrance, elle éprouve une attraction dérangeante pour son corps, elle lui souhaite d’être plus heureuse, elle tient à elle. Je crois que c’est lié au fait de reconnaître qu’une autre personne est autre, et de le ressentir profondément. Et de vouloir être avec cette personne, aimer être avec elle malgré ses défauts. Donc, en fait, (dans Purity,) Andreas a beaucoup de défauts repoussants mais parce qu’il a eu une enfance difficile, parce que je pense qu’il a probablement lutté toute sa vie contre la maladie mentale, et parce que j’ai rencontré des gens comme ça, et parce qu’il n’est pas simplement quelqu’un de mauvais—il lutte constamment pour devenir meilleur—j’ai été très touché par son désir, et je crois qu’il est sincère, d’être quelqu’un de meilleur. C’est mon point de connexion avec lui. Peu importent ses actes, il est conscient de ce qu’il fait, il y pense, et il essaie d’être honnête. Il a aussi beaucoup de qualités. Et aussi, vous savez, l’amour c’est en grande partie une identification à l’autre. Et moi je suis, vous savez, quelqu’un qui a de nombreuses facettes. Et je n’ai pas nécessairement envie que toutes ces facettes soient dévoilées au monde sous forme non-fictionnelle.
Cette interview est l’occasion de le faire.
Exactement. Je sais à quoi ressemble la paranoïa. Je sais ce que c’est que s’inquiéter de ce que les gens racontent sur vous, et de devenir obsédé par ce que les gens disent de vous. Toutes ces chose que vit (Andreas)—il est bien plus célèbre qu’aucun auteur ne le sera jamais—mais certaines choses autour de la célébrité, vous voyez, je m’y suis identifié.
A LIRE AUSSI
Les plans cul d'Emma Bovary ou la littérature française vue par l'oeil des critiques d'Amazon
Lire l'article
Avez-vous déjà été obsédé par ce que les gens disent de vous?
(Longue pause.) Oui, d’une façon très négative. Dans la mesure où je suis capable de grandes choses pour ne pas entendre ce que les gens disent sur moi. Mais ça c’est une forme de, eh bien, une forme d’autoprotection parce que je sais qu’il me suffit d’entendre une seule phrase—on va me rapporter en toute innocence, oh, que quelqu’un a dit un truc sur moi ou sur quelque chose que j’ai écrit, comme quand j’ai rédigé cet article pour le New Yorker il y a un an et demi où je pensais avoir exposé quelques arguments raisonnables sur la réalité du réchauffement climatique et le caractère inexorable d’un changement climatique radical, et que les gens ont dit: «Oh mon Dieu, quelqu’un t’a traité de tête de linotte. Quelqu’un a dit que tu réfutais la réalité du réchauffement climatique.»
Il suffit d’une toute petite phrase sur moipour m’empêcher de dormir la nuit pendant des heures
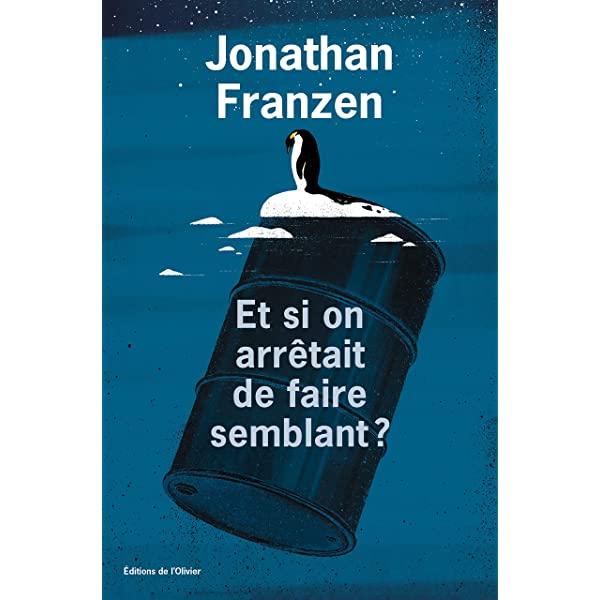
Et il suffit d’une toute petite phrase comme ça pour m’empêcher de dormir la nuit pendant des heures, à construire des réparties lapidaires et dévastatrices à l’intention d’un quelconque crétin... non mais vraiment, une seule phrase suffit à m’empêcher de dormir pendant des heures.
Il semble que vous soyez tout à fait partant pour donner votre point de vue sur des sujets controversés pourtant.
Euh, ouais.
C’est assez surprenant si vous savez que vous serez blessé par les réactions.
Eh bien c’est vrai, mais vous n’êtes blessé que si vous entendez les réactions.
D’accord, mais ces choses ont le chic pour se glisser jusqu’à nos oreilles.
Les choses se débrouillent parfois pour contourner le pare-feu, c’est vrai, mais c’est une équation compliquée. Je suis conscient d’avoir eu beaucoup de chance—d’avoir probablement été objectivement sur-récompensé en tant que romancier américain et journaliste et essayiste occasionnel—et je suis conscient d’avoir bénéficié dès le départ de privilèges dans lesquels je n’étais pour rien, en commençant par une bonne santé, par le fait d’être blanc, d’avoir eu les parents que j’ai eus, une bonne éducation jusqu’à un certain niveau, et aussi, parce que je suis sur-gratifié pour ce que je fais, je n’ai pas besoin de me préoccuper tous les mois des traites de la maison. Alors j’ai l’impression que parce que je jouis de ces privilèges, de ces luxes, il est de mon devoir de prendre la parole dès que je peux parce que je suis mieux placé pour encaisser la sanction que ne le serait quelqu’un dans une position moins assurée. Ça l’explique en partie.
Je ne suis pas du genre à chercher la confrontation; je ne me considère pas comme quelqu’un de courageux, mais je soupçonne que si ce pays tombait dans le fascisme et que les journalistes étaient persécutés et la liberté d’expression foulée au pied, alors je m’érigerais contre ça et je me prendrais sûrement une balle, simplement parce qu’il y a quelques choses vraiment importantes à mes yeux.
A LIRE AUSSI
Les ravages de Bret Easton Ellis sur la littérature française
Lire l'article
Est-ce que les commentaires stupides sur les médias sociaux vous touchent? Et les longues critiques réfléchies? Vous vous lancez dans ce genre de choses?
Non. Je ne lis même pas les bonnes critiques à moins que huit personnes différentes m’aient absolument certifié qu’elles ne contenaient pas la moindre chose susceptible de me contrarier.
Vraiment?
Oui. Vous savez, même un très gentil compte-rendu va dire, va faire une petite critique cachée—pas cachée mais juste pour la forme, parce qu’ils ne veulent pas être vus comme complètement, pitoyablement positif, alors qu’évidemment, ce que l’écrivain veut vraiment c’est lire des critiques pitoyablement positives. Et c’est genre (il change de voix): «C’est une super critique, dommage vraiment que tu aies ce petit paragraphe négatif». (Il rit.) «Parce que je ne suis pas d’accord avec votre critique! Vous ne comprenez donc pas pourquoi j’ai fait ça?!» Ou, ou, encore mieux, une critique absolument dithyrambique mais dont l’auteur n’a pas compris un truc et vous descend parce qu’il l’a mal interprété. Et là c’est: «Arrrrrrrrghhh, mais c’est clair dans le livre, vous l’avez juste mal lu!» Pourquoi voudriez-vous faire ça?
Je ne voudrais pas que vous vous sentiez obligé de vous allonger sur le divan pour répondre, mais pourquoi ce genre de choses vous dérangent-elles à ce point?
(Il se lève).
Vous allez sur le divan?
Non, non. (Il prend mon verre pour me resservir de l’eau).
Alors pourquoi pensez-vous que ça vous contrarie à ce point?
Eh bien, je ne crois pas être le seul dans ce cas.
Vous pensez que vous êtes juste plus honnête à ce sujet?
Ça, je ne sais pas. Une des grandes répliques de Denny Hastert était : «Je ne me vante pas de ma propre humilité».
OK, bon.
On peut se perdre dans cette phrase et passer de longues minutes à tenter de s’en sortir.
C’est exactement ce que je suis en train de faire.
J’ignore mon niveau d’humilité.
Mon éditeur de longue date, Jonathan Galassi, aime à dire (il prend une voix grave): «Un écrivain n’oublie jamais un affront.» Je crois que c’est universel. Nous n’oublions jamais un affront. Les écrivains sont incroyablement jaloux, et aussi, voilà, ils sont rancuniers.
A LIRE AUSSI
David Foster Wallace, l'infini philowophe
Lire l'article
Y a-t-il des écrivains que vous jalousez?
Plus tellement maintenant que je suis bien installé dans mon identité.
Mais dans l’univers de dessin animé qu’est l’imagination de l’écrivain, tous les deux, trois, quatre, cinq ans, le pays entier devrait cesser tout ce qu’il est en train de faire et s’occuper pendant plusieurs mois du nouveau livre de tel écrivain. Et il devrait y avoir des comptes-rendus partout, et on devrait se bousculer pour savoir ce que cet auteur a écrit, et il devrait rester au top des ventes pendant plusieurs années, et puis tout devrait retomber jusqu’à la sortie du livre suivant. Alors peu importe votre succès à vous, si vous n’avez pas un livre qui vient de sortir et que vous voyez quelqu’un qui attire toute l’attention, il y a une petite voix en vous qui dit: «Mais pourquoi ils s’intéressent à cette personne? Est-ce que tout le monde a lu mon livre?» C’est fou. Ce que l’écrivain désire en secret, c’est complètement dément.
Il se trouve que moi, même si je sens que je suis sur-gratifié par rapport à ce que je fais, je me dis: «D’accord, mais je n’ai pas remporté ce prix-là. Qu’est-ce qui s’est passé?» Ce n’est pas vraiment de la jalousie, mais dans l’imagination de l’écrivain, il y a un jeu à somme nulle. Tout ce que les autres obtiennent vous est enlevé, à vous. Vous pouvez être très rationnel face à ça et décider: «C’est débile, il y a de la place pour tout le monde sous le soleil.» Mais je ne sais pas. Peut-être que ce n’est pas un sentiment universel. Peut-être suis-je quelqu’un de foncièrement mauvais.
L’écrivain travaille à partir de rien. On n’a même pas d’instrument. C’est tout: votre pauvre petit ego est là, sans protection aucune
Je suis sûr que ce sentiment touche d’autres professions.
Mais c’est très propre aux écrivains. L’écrivain le ressent tout particulièrement parce qu’on travaille à partir de rien. On n’a même pas d’instrument. C’est tout: votre pauvre petit ego est là, sans protection aucune, sans percussionniste ou bassiste derrière qui se cacher. Vous pouvez choisir n’importe quels mots dans n’importe quel ordre—il n’y a pas de règle pour ça. Alors ce truc-là, il y a votre nom dessus, et c’est vous qui en êtes l’auteur absolu. C’est une expression de qui vous êtes. Donc je pense que chez l’écrivain, l’ego est exposé de façon unique aux vicissitudes de la réalité.
Comment conciliez-vous le fait de ne pas vouloir lire des critiques sur les médias sociaux avec l’importance à vos yeux de certaines questions concernant Internet et la démocratie et votre volonté, j’imagine, d’intervenir sur le sujet? Pour comprendre les médias sociaux, faut-il s’y impliquer?
(Il ne dit rien).
Parce que vous ne passez pas vos journées sur Twitter, je suppose.
Non, je ne passe pas ma journée sur Twitter. (Mon ressenti sur la question) est tiré de mon expérience en tant qu’auteur de fiction, qui est qu’il ne vaut mieux pas en savoir trop. Allez-y, goûtez-y un peu, suivez votre intuition: que vous dit votre instinct sur ce que vous êtes en train d’observer? Et puis prenez du recul et réfléchissez-y vraiment, et utilisez votre imagination. Vous savez, la dent que j’ai contre la Silicon Valley remonte simplement à cet instinct animal qui me dit que cette technologie ne semble pas avoir libéré les humains. On dirait que les gens se baladent enchaînés à leurs smartphones. D’un point de vue comportemental, c’est l’impression que ça donne.
(Et aussi, j’ai étudié) dans le genre de fac de sciences humaines où on vous récompense si vous tenez des discours savants sur des sujets dont vous avez juste survolé un chapitre vite fait la veille de l’examen. Mais en tant qu’auteur de fiction… si vous faites vraiment très attention aux petites choses, vous pouvez en tirer beaucoup. Une seule expérience vécue intensément peut beaucoup inspirer l’écrivain.
N’y a-t-il aucune contradiction entre cela et ce que vous avez dit tout à l’heure, sur le fait de ne pas avoir envie d’écrire sur les questions raciales à cause de votre manque d’expérience?
Je trouve que c’est vraiment dangereux, pour un Américain blanc progressiste, d’estimer que vos bonnes intentions suffisent à vous embarquer dans une œuvre d’imagination sur l’Amérique noire
Non, il s’agissait d’amour. Là, il s’agissait d’amour. Je trouve que c’est vraiment dangereux, pour un Américain blanc progressiste, d’estimer que vos bonnes intentions suffisent à vous embarquer dans une œuvre d’imagination sur l’Amérique noire. Je suis particulièrement vigilant sur ce point. J’y ai réfléchi—vous savez, les questions raciales sont très importantes en Amérique.
A LIRE AUSSI
Pourquoi en France les couvertures de livres sont-elles si sobres?
Lire l'article
Avez-vous déjà pensé à écrire un livre plus court, ou des nouvelles? Vos derniers livres étaient des pavés.
Tous mes romans font la même épaisseur: environ 530, 540 pages. C’est la taille qui me convient. Nell Zink me harcèle pour que j’écrive un genre de nouvelle à la Ethan Frome (d'Edith Wharton), qui serait étudié au lycée parce qu’elle veut que mon patrimoine littéraire continue de recevoir d’énormes sommes d’argent qui pourraient être dirigées vers la protection des oiseaux.
Pour en revenir à Trump: George Saunders a écrit cet article pour le New Yorker où il raconte être allé aux meetings de Trump—
C’est un très bon article.
Cela vous aurait intéressé qu’on vous demande de l’écrire?
C’était un super article pour George. Exactement ce qui lui fallait. Moi j’ai essayé un été d’être correspondant pour le New Yorker à Washington.
C’est à ce moment-là que vous avez écrit sur Hastert?
Mon article sur Denny Hastert, oui.
Ce n’était pas une très bonne expérience, lorsque j’étais à Washington. Saunders a de toute évidence fait un article totalement différent, pour lequel son incroyable empathie et son implication envers ceux qui travaillent tout en bas de l’échelle sociale de l’Amérique lui ont été utiles. C’était idéal pour lui. Mais je trouve aussi la politique très déroutante, ces derniers temps. Je trouve Washington délicieusement ennuyeux.
Vous voulez dire que vous n’éprouveriez pas la même empathie?
Saunders est bien meilleur que moi pour engager la conversation avec un supporter de Trump. J’en suis capable, mais ça me met mal à l’aise. Il peut le faire avec un genre de sincérité que je n’aurais pas, je pense. Je ne sais pas. Je travaille bien à l’étranger parce que les gens n’ont pas d’idées toutes faites sur le genre de personne que je suis en fonction de mes lunettes ou de mes vêtements.
Que pensez-vous que vos lunettes et vos vêtements renvoient comme image de vous?
(Ou) juste ma façon de parler.
C’est une question de diction, peut-être. Juste la manière dont les voyelles et les consonnes sont articulées et prononcées.
Vous articulez bien.
J’articule bien. Ce n’est pas intimidant quand je parle par le biais d’un interprète, donc quand je fais des reportages à l’étranger, ce n’est pas un problème, je me mets juste à parler aux gens. Ici c’est un peu différent.
Vous paraissez avoir des opinions politiques plutôt progressistes—
Tout à fait. Je suis un démocrate progressiste.
Vous savez que beaucoup de réactions que vous suscitez sont sûrement que vous êtes un homme blanc qui écrit sur des trucs d’hommes blancs.
Et pourtant certaines personnes aiment ça, donc on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. D’ailleurs si vous plaisez à tout le monde, vous feriez mieux de vous inquiéter. J’écris pour les gens qui aiment le genre de livres que moi, j’aime.
Comment définiriez-vous les livres que vous écrivez?
Eh bien en tout cas ce ne sont pas des romans politiques, ça c’est sûr.
Vous ne trouvez pas que vos livres sont politiques? D’accord, ce n’est pas Tempête à Washington. Mais ils sont politiques quand même, non?
Ils prennent en compte l’univers de la politique, mais ils n’en prônent aucune en particulier. Et vous n’avez pas besoin de partager les opinions de l’auteur pour les apprécier.
Quelles sont vos habitudes de travail quand vous écrivez vos livres?
Oh, j’ai tellement rarement d’habitudes d’écriture. (Il rit). J’aimerais écrire tout le temps, mais les jours où ça arrive sont tragiquement rares. Quand j’écrivais mon dernier article qui a été publié, un papier sur l’Antarctique pour le New Yorker, je me levais à 8heure du matin, je prenais mon petit-déjeuner et je lisais la version papier du New York Times, à laquelle je suis toujours abonné.
Et puis je prenais la voiture et je faisais dix minutes de route jusqu’à mon bureau sur le campus. C’est une petite pièce sombre, froide et tranquille, j’y travaille dans l’idéal pendant six heures et j’essaie de pondre 1.000 mots, et je rentre à la maison où je passe deux heures sur mes mails. Ensuite je vais à la salle de sport, ou je joue au tennis, je bois un verre; Kathy revient d’aller voir sa mère; nous dînons, nous regardons la télévision; nous lisons. Ce sont des jours heureux.
Ça pourrait être pire.
Ça pourrait être bien pire, en effet. Je suis payé pour ça. C’est remarquable.
A LIRE AUSSI
Les booktubeurs vont-ils devenir les nouveaux YouTubeurs mode?
Lire l'article
Vous avez dit que vous aviez un bureau sur le campus. Qu’enseignez-vous?
Je n’enseigne pas. Je n’enseigne plus depuis 1997.
Vous entrez par effraction dans le bureau de quelqu’un d’autre?
Non, non, comment dire ça? J’ai une relation de travail avec une des facultés (à l’UC–Santa Cruz) et je fais des choses comme des discours de remise de diplômes.
Deux heures sur vos mails, c’est intéressant.
Oui assez, c’est vrai. On va dire au minimum une heure. Je dirige une entreprise, déjà, donc tous les jours j’ai des mails de travail qui me demandent de faire plein de choses, et je n’ai personne qui serait capable de trouver le moyen de leur dire gentiment non. Donc je dois faire ça. Et c’est lassant. Vous pouvez avoir trois demandes dans la journée, et vous ne pouvez en satisfaire aucune, mais au moins vous voulez être gentil avec la personne qui demande.
Vous avez été gentil avec moi à chaque fois que vous m’avez dit non avant d’accepter de faire cette interview.
Bien, je suis content que ce soit le souvenir que vous en gardiez. Ça n’a pas été écrit par une assistante, laissez-moi vous le dire. Il faut prendre ça en compte. Et puis il y a les trucs des agents, et dernièrement de la télévision, et puis tous les amis. Ce ne sont pas forcément des mails très longs. Une des raisons pour lesquelles j’essaie de rester à jour c’est que vous n’êtes pas obligé d’écrire un long mail si vous répondez rapidement, alors que si vous laissez une ou deux semaines passer vous vous sentez obligé d’écrire davantage. Si vous laissez ça en plan pendant un moment, vous avez l’impression d’être obligé d’écrire toute une lettre.
Vous avez évoqué la télévision. Qu’est-ce que ça vous fait que votre œuvre soit adaptée?
Comme ils disent dans New York, police judiciaire, «Votre honneur, ils ont ouvert la porte à cette question.» (Il rit). «Il a raison, maître.»
J’ai interviewé Jhumpa Lahiri il y a quelques années et lui ai demandé ce que ça lui faisait que son roman Un nom pour un autre soit adapté au cinéma, et elle a simplement répondu, en gros, que c’était Mira Nair [la réalisatrice] qui l’avait fait: «C’était son Un nom pour un autre à elle.»
J’ai tiré une franche satisfaction de l’échec des tentatives à adapter Les Corrections
Eh bien, Les corrections a déjoué toute tentative d’adaptation mis à part une pièce radiophonique en 12 parties pour la BBC. Je pense que c’est la seule chose que quiconque ait jamais réussi à faire avec ce livre. Ce qui comprend l’équipe à laquelle j’appartenais et qui a tenté de réaliser une série télé pour HBO sur quatre ans, tentative mal conçue au final. J’ai tiré—je ne dirais pas une satisfaction perverse—j’ai tiré une franche satisfaction de l’échec des tentatives à adapter ce livre. Du genre: «Ouais, parce que c’est un roman. Les romans sont des romans, c’est tout.»
Le parrain aussi était un roman.
C’est vrai. Bon, Les corrections était un peu moins direct dans l’histoire qu’il racontait, un peu structuré d’une façon différente. Non, pas un peu—il n’était pas structuré pareil. Et au final j’ai été très soulagé que cette série ne soit pas choisie après la réalisation du pilote parce que je sentais que je retournais vers quelque chose qui était terminé pour moi.
Aujourd’hui, je suis de nouveau impliqué dans une adaptation en tant que producteur délégué et auteur. Je l’adapte avec deux autres personnes, notamment Todd Field, un type bourré de talent qui a une idée qui m’enthousiasme beaucoup. Je ne ressens pas le même sentiment de «Beurk, j’en ai marre de ce sujet» que j’avais avec Les corrections. Je crois que cela a sans doute un rapport avec le moment. Aucun autre livre ne se dresse entre moi et Purity. Il est encore frais, en quelque sorte. Je travaillais encore sur ce livre il y a quinze mois. La blessure est encore ouverte, donc ce n’est pas aussi douloureux d’y retourner.
Purity semble aussi plus facile à adapter.
Vous l’avez remarqué, Todd l’a remarqué, oui.
A LIRE AUSSI
Ce que les séries nous ont appris de la sexualité féminine
Lire l'article
Qu’est-ce que vous regardez à la télévision? Je suis sûr que vous avez entendu le cliché selon lequel les séries télé sont les nouveaux romans du XIXe siècle.
J’ai dû revoir ma définition du roman pour y inclure les séries télévisées du câble, simplement parce que la manière dont la télévision retrouve son chemin vers la forme de feuilleton à la Dickens et Dostoïevski est frappante
Est-ce que la télé compte pour beaucoup dans votre consommation culturelle actuelle?
Terriblement, oui. Au point que j’ai dû revoir ma définition du roman pour y inclure les séries télévisées du câble, simplement parce que la manière dont la télévision retrouve son chemin vers la forme de feuilleton à la Dickens et Dostoïevski est frappante. Ils écrivaient tous sous cette forme de feuilleton à l’époque. Le roman social est mort tué par le film et la télévision, et pourtant il avait donné du plaisir, des satisfactions au XIXe siècle. Des gens sont nés après la mort de cette forme de récit, mais je pense qu’il reste encore une faim naturelle pour ce genre de choses.
Des séries préférées?
Eh bien c’est un peu gênant à avouer: nous avons commencé la troisième saison de Silicon Valley, on en a déjà regardé deux épisodes. On s’est dit qu’on aimait follement cette série, et comme on ne se rappelait pas de tous les rebondissements qui avaient amené les personnages jusque-là, alors on vient juste de finir de re-regarder les deux premières saisons.
Qu’est-ce que vous lisez en ce moment? De la fiction contemporaine ou de plus vieux trucs?
Les deux. J’ai lu beaucoup de classiques, mais j’en relirai. Il y a eu ce moment merveilleux il y a un an et demi lorsque je me suis rendu compte que j’avais mis Hardy sur la touche à cause d’une expérience traumatique lors de mes premières années de fac avec Jude l'obscur. En fait il se trouve que Hardy est l’un des plus grands romanciers en langue anglaise de tous les temps.
Et des romans actuels?
Eh bien je suis toujours à l’affût d’un bon roman. Il y en a un que j’ai beaucoup aimé et admiré il y a quelques mois, et je suis un peu gêné d’avouer que je ne sais pas comment prononcer son nom de famille, c’est celui de Tony Tulathimutte. C’est un livre qui s’appelle Private Citizens. Dans son génie, il en fait un peu trop. Mais c’est un vrai livre. Il a un grand talent. Ça m’a transporté. Je suis en train de lire le roman de Hannah Tennant-Moore, Wreck and Order. J’en suis à peu près au tiers. C’est bon.
À quel point vous intéressez-vous à la pop culture? Vous vous y sentez obligé quand vous écrivez de gros livres sur l’Amérique?
Non. Je suis fainéant. Je n’aime pas faire des recherches pour mes livres. Parfois je me mets moi-même un pistolet sur la tempe et je m’oblige à faire des recherches quand je ne connais rien à un sujet, mais l’idée de m’infliger des trucs juste pour collecter des impressions—je me reproche à moi-même de ne pas être un vrai romancier parce que je ne sors pas avec un cahier pour collecter des impressions. Je ne me fourre pas dans des situations difficiles pour tenter de pêcher de la matière.
Non, je ne consomme que la pop culture que j’apprécie. Donc j’en sais pas mal sur la NFL parce que je continue—c’est un peu pathétique comme confession, mais je continue de vraiment apprécier regarder les matchs de foot de la NFL. (Il rit).
Le football est tellement bien à la télévision que—
C’est génial à la télé! Tout. Les règles, les décisions des arbitres. C’est une chose superbe. Je m’y connais un peu en baseball aussi. Et je suis très calé sur un assez petit nombre de groupes de rock avec lesquels je me suis trouvé extrêmement impliqué à une époque où j’avais besoin d’avoir de la musique à écouter.
Je suis aux deux-tiers du chemin de ma vie. Il y a des genres de musique entiers dont je ne saurai jamais rien. OK, d’accord, et alors? Il y a plein de gens qui ne connaissent pas grand-chose aux styles qui me plaisent. Quand je parle de Wussy la plupart du temps on me regarde avec des yeux ronds. Même avec les Mekons on me regarde avec des yeux ronds.
C’est ce qui est en train de se passer, là.
Voilà, exactement. Ils ne connaissent pas ces groupes et moi je ne connais pas leurs groupes et c’est très bien comme ça. Et le reste c’est tout ce qui passe par mon filtre, et mes filtres en fait c’est le New Yorker et le New York Times. Et je passe beaucoup de temps à m’occuper d’oiseaux et de protection des oiseaux, alors ça empiète sur ma consommation de pop culture.
Juste pour revenir sur les critiques: devoir gérer les critiques, c’est un des inconvénients de la célébrité, non?
Il y a plein de gens qui ne sont pas célèbres et qui se font jeter des pierres tous les jours.
C’est vrai, mais c’est plus rare que ce soit en continu.
Ouais. Je reviens sur New York, police judiciaire, et je dis: «Objection, un écrivain célèbre, ça n’existe pas». Et le juge répond: «Laissez-le poursuivre.»
Dans quelle mesure estimez-vous que la célébrité vous a changé ou a changé votre vie?
En stipulant qu’un écrivain célèbre, ça n’existe pas.
Vous n’êtes pas George Clooney. Je ne suis pas en train de dire que c’est la même chose.
Tu m’étonnes. Parce que George Clooney ne peut pas prendre le bus à New York. Vos possibilités d’être une personne dans le monde sont vraiment limitées quand vous êtes très célèbre. Vous ne sortez pas sans garde du corps par exemple.
Le vôtre m’a laissé entrer.
Je sais. Je les ai virés en vous voyant arriver.
J’ai probablement été contacté par davantage de gens de mon enfance que si je n’avais pas été un peu connu. Évidemment, il m’aurait suffi d’aller sur Facebook, et j’aurais eu des nouvelles de tous ces gens.
Vous ne vous êtes pas aventuré sur Facebook?
Non, non, je ne vois pas où je trouverais les quatre heures nécessaires pour ça dans ma journée. (Il rit). Non, j’ai tort de jouer les narquois sur le sujet. Professionnellement, je ne suis pas obligé d’y être. (Il prend une voix sarcastique). Je reconnais que c’est un privilège, mon éditeur ne me harcèle pas pour que je fasse ma propre promotion sur Facebook.
Mais j’essaie de prendre votre question au sérieux.
De temps en temps, on a une occasion de parler et d’attirer l’attention sur quelque chose parce qu’on est connu
OK, j’étais en Australie. C’est vraiment anecdotique, mais le gouvernement australien a une commission de productivité qui, essentiellement, essaie de retirer leur protection aux libraires, éditeurs et auteurs australiens, dans le sens où de nombreux autres pays avec des politiques plutôt orientées vers le libre-échange comme les États-Unis et le Royaume-Uni protègent encore leurs auteurs, leurs éditeurs et leurs libraires. Donc j’ai assisté à l’assemblée annuelle d’une association de libraires et j’ai remis un prix à quelqu’un. J’ai dit que même en Amérique, nous ne sommes pas aussi bêtement amourachés de l’économie de marché au point de ne pas protéger nos éditeurs. C’est tout ce que j’ai dit. Et ça a fonctionné. Et ça n’aurait pas marché si je n’avais pas été un écrivain américain connu de passage. J’ai eu l’impression d’avoir réalisé une petite mitzvah là-bas. De temps en temps, on a une occasion de parler et d’attirer l’attention sur quelque chose parce qu’on est connu.
Mais vous n’avez pas l’impression que les gens vous traitent différemment?
Je ne doute pas que certains le fassent. Et on peut très bien devenir parano: «Ils ne m’aiment pas, moi. Ils m’aiment à cause de mes jouets. Ils m’aiment parce que je vis dans la grande maison de mes parents» ou toutes ces fantaisies paranoïaques qui ont été si joliment traitées dans, euh, pas Wolfcatcher (il claque des doigts), vous savez, le film de Steve Carell, Fox …
Foxcatcher.
Merci. Foxcatcher—mon cerveau a buggé—qui est un super film justement sur ce pouvoir d’isolement de la richesse, dans ce cas. Mais la fortune et la célébrité fonctionnent un peu pareil dans la mesure où il vous font vous demander si les gens vous aiment vous, ou s’ils aiment ce que vous représentez.
Je me suis posé la question pour Trump, et dans quelle mesure la richesse et la célébrité l’ont affecté. Je crois qu’il a peut-être une maladie mentale.
Ouais, celui-là n’augure franchement rien de bon pour l’avenir. S’il est élu président, cela ne fera que s’aggraver, cette maladie mentale.
Je vis avec quelqu’un qui m’aimait déjà quand je n’avais rien
Vous avez dit que votre courage se manifesterait si un fasciste prenait le pouvoir et se mettait à emprisonner les journalistes, et que vous n’auriez pas peur de vous y opposer—eh bien, vous allez peut-être pouvoir le faire.
Exactement, exactement. Ce qui fait obstacle à cette possibilité, c’est mon aversion des meetings. Mais juste pour compléter cette réflexion (il fait une pause de 30 secondes.) Mes amis sont encore mes amis, et la plupart d’entre eux le sont depuis tellement longtemps que je sais qu’ils m’aiment pour ce que je suis et oui, on repère assez facilement quand quelqu’un est sympa juste à cause de ce que vous représentez et de votre personnage public. Et ça m’arrive de le tolérer. Mais en gros, je suis entouré de beaucoup de réalité. Je vis avec quelqu’un qui m’aimait déjà quand je n’avais rien.
Et maintenant nous pouvons enfin aborder la question des oiseaux.
OK. (Il rit). Qu’est-ce que vous voulez savoir?